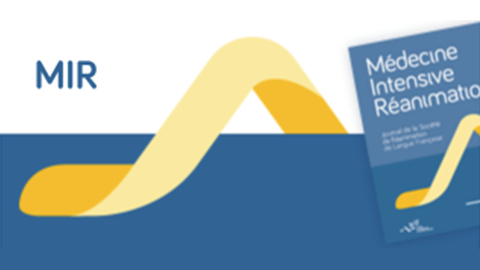
La surveillance biologique de l’héparine non fractionnée (HNF) repose sur la mesure de l’activité anti-Xa, ou à défaut du TCA. En pratique clinique, l’expression « résistance à l’héparine » est couramment utilisée lorsque des doses d’HNF considérées comme « anormalement élevées » ne permettent pas d’atteindre l’intervalle thérapeutique ciblé. Cette définition arbitraire s’avère particulièrement inappropriée chez les patients de réanimation car elle ne tient pas compte du poids, ni des modifications liées à la pharmacocinétique et/ou de la pharmacodynamie de l’HNF, ni du contexte clinique, ni des facteurs impactant le TCA. Dans la majorité des cas, la nécessité d’augmenter les doses d’HNF administrées pour atteindre l’intervalle thérapeutique ciblé s’explique par des variations interindividuelles de la pharmacocinétique et /ou de la pharmacodynamie du médicament. L’utilisation de nomogrammes adaptés au poids, plutôt qu’une augmentation arbitraire des doses d’HNF, permet, dans la plupart des cas, d’atteindre rapidement une anticoagulation thérapeutique. En cas de déficit acquis en antithrombine <60%, le bénéfice clinique de l’administration de concentrés d’antithrombine pour optimiser l’anticoagulation n’est pas démontré. Les données sur l’efficacité et la sécurité des inhibiteurs directs de la thrombine demeurent insuffisantes pour les proposer comme alternative à l’HNF en dehors du traitement des thrombopénies induites par l’héparine.