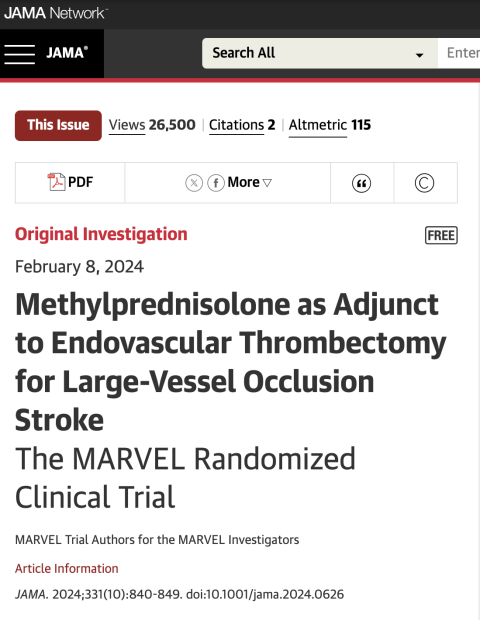
Methylprednisolone as Adjunct to Endovascular Thrombectomy for Large-Vessel Occlusion Stroke: The MARVEL Randomized Clinical Trial, MARVEL Trial Authors for the MARVEL Investigators
Shan Y, Pu J, Ni Y, Liu Z, Zou X, Wu C, Liu J, Qi L, Chen J, Wang P, Luan J, Liu D, Song B, Hao Y, Qiu T, Wang K, Li Z, Liu J, Li Z, Li Y, Yang S, Lin X, Cheng W, Chen A, Yan S, Liu S, Du J, Chen Z, Yao L, et al.
JAMA. 2024;331:840. DOI : 10.1001/jama.2024.0626
Question évaluée
Les corticoïdes (méthylprednisolone à la dose de 2mg/kg/j pendant 3 jours), lorsqu'ils sont utilisés en complément d'une thrombectomie endovasculaire, améliorent-ils le pronostic fonctionnel des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) aigu en rapport avec une occlusion d'un gros vaisseau ?
Type d’étude
Essai randomisé, contrôlé contre placebo, en double aveugle, mené dans 82 hôpitaux en Chine.
Population étudiée
Critères d’inclusion :
- Age ≥ 18 ans
- Infarctus cérébral sur occlusion artérielle d’un gros vaisseau (carotide interne ou artère cérébrale moyenne) avec indication à une thrombectomie endovasculaire.
- Pris en charge dans les 24h du début des symptômes
- Score NIHSS ≥ 6 (AVC considéré comme modéré si score 5-14, sévère si score 15-20, grave si > 20) [1].
- Un infarctus cérébral de taille petite à étendue, définie par un score ASPECTS 3-10. Il s’agit d’un score radiologique évaluant la taille d’un AVC du territoire de l’artère cérébrale moyenne à partir d’une TDM cérébrale non injectée [3].
Critère d’exclusion particulier :
- Insuffisance rénale chronique avec DFG < 30mL/min.
Méthode
Les patients ont été randomisés pour recevoir, en complément d’une thrombectomie endovasculaire, soit de la méthylprednisolone à la dose de 2 mg/kg/jour, soit un placebo pendant trois jours.
Le critère de jugement principal était la distribution du handicap fonctionnel à 90 jours selon le mRS, avec des scores allant de 0 à 6, où 0 représente l'absence de symptômes, et 6 indique le décès [2]. Les critères de jugement secondaires comprenaient notamment le mRS dichotomisé à J90 selon différents seuils. Les critères de jugement de sécurité étaient, entre autres, une transformation hémorragique dans les 48h de la thrombectomie, la survenue d’une pneumonie et la survenue d’un diabète.
Les analyses principales ont ajusté les résultats pour 7 covariables prédéfinies, dont l'âge, le NIHSS, le score ASPECTS, l'utilisation de thrombolyse intraveineuse, le délai entre les premiers symptômes et la randomisation, et la localisation de l'occlusion.
La méthodologie statistique utilisée est inhabituelle, liée au choix du critère principal : le mRS a été gardé en variable ordinale, et non dichotomisé comme souvent. Vu que l’effet du traitement ne sera pas constant entre chaque niveau, l’effet du traitement a été évalué par la méthode du Win Ratio, en comparant des paires de patients des deux bras et en relevant quel bras a le meilleur mRS (« win »). Un odds ratio généralisé (GenOR) est calculé à l’issue des comparaisons et indique la probabilité que le mRS soit meilleur dans le bras intervention.
Résultats essentiels
De février 2022 à juin 2023, 1680 ont été randomisés (839 bras méthylprednisolone, 841 bras placebo). A J90, il n’y avait pas de différence significative entre les 2 bras dans la répartition des scores mRS (mRS 3 IQR [1–5] pour la méthylprednisolone vs 3 [1–6] pour le placebo, GenOR ajusté = 1.10, IC95% [0.96–1.25], p = 0.17) indiquant une absence de différence en termes de handicap global.
Cependant, des différences ont été mises en évidence dans les critères de jugement secondaires. La mortalité à 90 jours était plus faible dans le groupe méthylprednisolone (23.2% vs 28.5%, RR ajusté (RRaj) = 0.84, IC95% [0.71–0.98], p = 0.03), et la proportion de patients avec mRS 0-4 (vs 5-6) meilleure dans le groupe méthylprednisolone (71.5% vs 66.2%, RRaj 1.07, IC95% [1.00–1.14], p = 0.04). Cette différence n’était plus significative pour des seuils de dichotomisation différents (mRS 0-2 vs 3-6 ou mRS 0-3 vs 4-6). Par ailleurs, l’incidence des hémorragies intracrâniennes symptomatiques dans les 48h suivant la thrombectomie était réduite dans le groupe méthylprednisolone (8.6% vs 11.7%, RRaj 0.74, IC95% [0.55–0.99], p = 0.04).
Sur le plan des critères de sécurité, la méthylprednisolone était associée à une réduction de l’incidence des pneumonies (46.5% vs 55.4%, RRaj 0.85, IC95% : [0.77–0.93], p < 0.001). En revanche, l’utilisation de méthylprednisolone était associée à une incidence augmentée de diabètes de novo (4.8% vs 2.9%, p = 0.04) et une utilisation plus importante d’insuline au cours de l’hospitalisation (19.7% vs 13.1%, p = 0.0003).
Commentaires
L’étude MARVEL montre donc que 3 jours de corticothérapie par 2 mg/kg de méthylprednisolone en association à une thrombectomie endovasculaire n’améliore pas significativement le pronostic fonctionnel à J90, mais semble améliorer la survie.
En analysant plus précisément la répartition des mRS dans les 2 bras, l’éventuel bénéfice d’une corticothérapie serait principalement médié par la plus faible mortalité, mais également pour les patients avec un handicap modéré (mRS 2 et 3). Ces gains pourraient être expliqués par l’incidence plus faible des hémorragies intracrâniennes symptomatique. Ces résultats peuvent être mis en perspective avec les mécanismes physiopathologiques attendus des anti-inflammatoires sur la réduction de l'œdème cytotoxique et vasogénique. Néanmoins, en l’absence de plan d’imagerie protocolisé, il est difficile de conclure, d’autant plus que l’incidence plus faible de pneumonies dans le groupe corticoïde aura pu également influencer le pronostic [4]. Ces résultats doivent par ailleurs être interprétés avec précaution, les patients du bras corticoïdes ayant présenté plus de diabètes de novo et d’hyperglycémies, dont on connait les effets délétères dans les agressions cérébrales aigues.
Points forts
- Méthodologie robuste, taille de l'échantillon importante et conforme au plan statistique.
- Analyses secondaires et de sécurité permettant de mieux appréhender l’impact d’une corticothérapie à la phase aiguë de l’AVC ischémique.
- L'accent est ici mis sur la neuroprotection et l’amélioration de la microcirculation. En effet, grâce aux progrès de la thrombectomie, les taux de recanalisation peuvent aller jusqu’à 90% [5], approchant un plafond d’efficacité sur le plan de la macrocirculation, et qui justifie d’explorer des approches thérapeutiques complémentaires permettant d’améliorer la viabilité du tissu cérébral ischémié [6].
Points faibles
- Généralisation des résultats discutable, la population d’étude étant exclusivement chinoise. En effet, les populations asiatiques ont une incidence d’AVC ischémique plus élevée que les populations occidentales, plus d’athérome intracrânien et une plus faible incidence de cause cardio-embolique [7].
- Modalité d’administration de la corticothérapie. Les auteurs considèrent que la dose de corticoïdes administrée est faible (nous imaginons, par opposition à des bolus de 500 ou 1000mg), mais il s’agit quand même de 2mg/kg de méthylprednisolone avec des conséquences systémiques visibles dans les critères de sécurité. Le rapport bénéfice risque de doses inferieures n’est pas discuté par les auteurs. De même, le choix d’une durée de traitement courte de 3 jours n’est pas discuté.
- Le protocole de l’étude n’a pas inclus d'analyse d'imagerie, et il n'est pas possible de savoir si le gain de survie identifié sous corticoïdes est lié à une réduction du volume de l'infarctus, une réduction de l’œdème, ou à un effet systémique autre.
- L’étude a été réalisée pendant une partie de la période du COVID, et l’analyse en sous-groupe met en évidence un meilleur effet de la corticothérapie lors de la période avec contrôle strict des déplacements (GenORaj 1.25, IC95% [1.04–1.50] vs 0.95 [0.79–1.15]), sans qu’il n’y ait d’explication évidente à ce résultat.
Implications et conclusions
Bien que les résultats de l’étude MARVEL n’aient pas montré globalement de bénéfice significatif des corticoïdes sur le pronostic fonctionnel à J90, la réduction de mortalité observée ainsi qu’un bénéfice dans les strates de handicap modéré du mRS ne doivent pas être ignorés. Néanmoins, en présence d’un risque accru d’hyperglycémies et de diabètes de novo, la balance bénéfice-risque nécessite d’être évaluée dans des études complémentaires, notamment sur des populations ethniquement différentes.
RÉFÉRENCES
-
Brott T, Adams HP, Olinger CP, Marler JR, Barsan WG, Biller J, Spilker J, Holleran R, Eberle R, Hertzberg V. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke. 1989;20:864–70.
-
van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients. Stroke J Cereb Circ. 1988;19:604–7.
-
Barber PA, Demchuk AM, Zhang J, Buchan AM. Validity and reliability of a quantitative computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before thrombolytic therapy. ASPECTS Study Group. Alberta Stroke Programme Early CT Score. Lancet Lond Engl. 2000;355:1670–4.
-
Hannawi Y, Hannawi B, Rao CPV, Suarez JI, Bershad EM. Stroke-Associated Pneumonia: Major Advances and Obstacles. Cerebrovasc Dis. 2013;35:430–43.
-
Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, Dippel DWJ, Mitchell PJ, Demchuk AM, Dávalos A, Majoie CBLM, van der Lugt A, de Miquel MA, Donnan GA, Roos YBWEM, Bonafe A, Jahan R, Diener H-C, van den Berg LA, Levy EI, Berkhemer OA, Pereira VM, Rempel J, Millán M, Davis SM, Roy D, Thornton J, Román LS, Ribó M, Beumer D, Stouch B, Brown S, Campbell BCV, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. The Lancet. 2016;387:1723–31.
-
Siegler JE, Prabhakaran S. Adjunctive Steroids as Stroke Reperfusion Strategy. JAMA. 2024;331:829.
-
Kim BJ, Kim JS. Ischemic stroke subtype classification: an asian viewpoint. J Stroke. 2014;16:8–17.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Commenté par Étienne de Montmollin, Service de médecine intensive et réanimation infectieuse, Hôpital Bichat – Claude Bernard, APHP, Paris, France.
L'auteur ne déclare pas de conflit d'intérêt en lien avec cet article.
Le contenu des fiches REACTU traduit la position des auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Envoyez vos commentaires/réactions à l'auteur (etienne.demontmollin@aphp.fr) ou à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
C. DUPUIS
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
G. FOSSAT
N. HIMER
T. KAMEL
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
V. ZINZONI