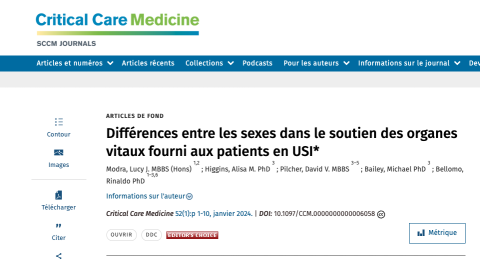
Sex differences in vital organ support provided to ICU patients
Modra, Lucy J., Higgins, Alisa M., Pilcher, David V., Bailey Michael, Bellomo Rinaldo, Critical Care Medicine january 2024.
DOI : 10.1097/CCM.0000000000006058
Question évaluée :
Bien que la prise en charge des patient·es admis.es en réanimation soit sensée être standardisée selon la pathologie, il existe des données récentes montrant que le sexe, l’origine ethnique ou le milieu socio-économique peuvent influencer le traitement reçu (1,2). Plusieurs études ont montré que les femmes étaient moins susceptibles de bénéficier de procédures telles que la ventilation invasive, l’épuration extra-rénale, les drogues vaso-actives, l’ECMO ou la trachéotomie (1,3). Néanmoins, beaucoup de ces études ne prenaient pas en compte un certain nombre de facteurs confondants comme la sévérité de la pathologie (4).
C’est dans ce contexte, afin d’évaluer précisément les différences de traitements reçus en réanimation entre les hommes et les femmes, qu’a été réalisée cette étude.
Objectif principal :
Évaluation de l’impact du sexe (masculin/féminin) sur l’introduction du support d’organe, l’hypothèse principale étant que les femmes reçoivent moins de ventilation invasive que les hommes, après ajustement sur les principaux facteurs confondants.
Objectif secondaire :
Décrire la relation entre le sexe, le support d’organe (spécifiquement : ventilation invasive, ventilation non-invasive, drogues vaso-actives, épuration extra-rénale et ECMO) et la mortalité.
Type d’étude :
Étude rétrospective observationnelle multicentrique, réalisée sur 199 services de réanimation d’Australie et de Nouvelle-Zélande.
Population étudiée :
Tous·tes les patient·es admis·es en réanimation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, âgé·es de plus de 18 ans, et dont les informations concernant le sexe, le support d’organe (notamment la ventilation invasive) et les limitations thérapeutiques étaient recueillies. Les patient·es identifié.es comme intersexe, ou dont le sexe n’était pas connu étaient exclu·es.
Il est à noter que l’étude se focalisait sur le sexe des patient·es (c’est-à-dire la différence biologique entre les femmes et les hommes), et non sur le genre, qui n’est pas toujours correctement retranscrit dans les registres.
Méthode :
Les variables paramétriques, exprimées en moyenne étaient comparées par le test de Student, les variables non paramétriques, exprimées en médiane, étaient comparées par le test de Wilcoxon. Les tests étaient réalisés avec un risque alpha à 0.01.
L’impact du sexe sur l’introduction de la ventilation mécanique invasive était évalué par une régression logistique, ajustée sur le score APACHE III et le diagnostic à l’admission. L’analyse était réitérée pour chacun des supports d’organe. Le groupe des hommes était le groupe de référence.
La mortalité chez les patient·es recevant un support d’organe et ceux/celles n’en recevant pas a été également évaluée par régression logistique, avec ajustement sur le sexe, le score APACHE III, le diagnostic à l’admission, la décision de limitation des thérapeutiques ainsi que l’année et le lieu d’hospitalisation.
Une analyse en sous-groupe (selon la médiane du score APACHE III) a également été réalisée afin d’évaluer la relation entre la gravité, le sexe et le recours au support d’organe.
Enfin des analyses de sensibilité ont été réalisées :
- après exclusion des patient·es ayant reçu un support ventilatoire dans les 24 heures de l’admission, afin d’étudier les patient·es présentant une dégradation au cours de l’hospitalisation.
- après exclusion des patient·es admis.es pendant les années correspondant à la pandémie COVID-19 (2020-2021), compte-tenu des différences de répartition homme/femme admis.e en unité de soins intensifs au cours de cette période.
Résultats essentiels :
Parmi les 763 207 patient·es admis.es au sein des 199 services de médecine intensive et réanimation du groupe ANZICS au cours de la période d’étude, 699 535 ont été inclus.es dans l’étude. 43.7% étaient des femmes. Elles étaient plus jeunes que les hommes (61,1 +/- 18,3 vs 63,2+/-16,6 ans), avec un score de sévérité moins élevé à l’admission (APACHE III 48,7+/-23 vs 51,2+/-23,4). Une consigne de limitation des thérapeutiques était plus fréquemment prise chez les femmes (8,3% vs 7,2%). La pathologie amenant en réanimation était moins souvent cardiovasculaire ou traumatique que pour les hommes et plus souvent liée à une cause rénale, métabolique, hématologique ou gastro-intestinale.
Moins de femmes que d’hommes recevaient les techniques de support d’organe suivantes : ventilation invasive (25,7% vs 37,3%), ventilation non-invasive (10.6% versus 10.9%), drogues vaso-actives (31.7% versus 39.8%) et dialyse (3.4% versus 4.6%). Ces résultats étaient retrouvés après ajustement sur la sévérité, le diagnostic, les limitations thérapeutiques et le lieu et l’année d’hospitalisation. Il n'existait pas de différence significative pour le support par ECMO.
L'usage moins fréquent de la ventilation invasive chez les femmes étaient retrouvé après exclusion des patient·es intubé·es dans les 24 premières heures, et avant la pandémie COVID-19, après ajustement sur les mêmes paramètres.
La mortalité en réanimation n’était pas différente selon le sexe (4% vs 4.7%). La mortalité à l’hôpital était plus faible chez les femmes (6,5% vs 7,5%, p<0.001 ; OR ajusté : 0,94, 99% CI : 0,91-0,97). Ce résultat était plus particulièrement retrouvé dans le sous-groupe de patientes n’ayant pas reçu de support d’organe. En effet, la mortalité des femmes était identique à celle des hommes dans le groupe ayant reçu un ou plusieurs support(s) d’organe.
Dans l’analyse complémentaire du sous-groupe à faible risque (APACHE III inférieur à la médiane), les femmes étaient moins souvent intubées (16,2% versus 28,6%), mais plus à risque de décès si cela se produisait (OR pour la mortalité : 1,17, 99% CI :1,01-1,36). Les femmes n'ayant pas été ventilées, avaient une mortalité plus faible que les hommes n'ayant pas été ventilés, après ajustement, quel que soit leur sous-groupe de sévérité.
Commentaires :
Cette étude rétrospective met en évidence une inégalité dans les supports d'organe administrés aux patient·es selon leur sexe, de même que dans la mortalité résultant de l'administration ou non de ces supports.
Points forts :
Plus grande cohorte multicentrique de patients allogreffés de CSH admis en réanimation.
Analyse des facteurs de risque de mortalité en individualisant les différents sous-groupes de GVH aigue et l’intrication des différents supports d’organe.
Points forts :
Cohorte de très grand effectif, sur plusieurs centres dans deux pays différents.
Recueil complet du type de support d’organe (ventilatoire - invasif et non invasif -, hémodynamique - drogues vaso-actives, ECMO, dialyse), ainsi que des décisions de limitations thérapeutiques.
Analyse ajustée sur le sexe, la sévérité à l’admission, le diagnostic, l’année et le lieu d’hospitalisation, et les éventuelles limitations thérapeutiques.
Points faibles :
Analyse rétrospective, mettant en évidence une relation entre le sexe et le recours aux supports d’organes, mais dont le mécanisme n’est pas étudié.
La définition du sexe est assimilée à celle du genre, recueilli dans le dossier médical. Les auteur.rices soulignent l’impact psychosocial du genre sur la santé et les biais de prise en charge.
Le taux de mortalité très faible de la cohorte reflète un case mix très large incluant des pathologies peu sévères qui ne requièrent aucun support d’organe.
L’étude ne distingue pas les consignes de limitations thérapeutiques relevant de la volonté expresse des patient.es (directives anticipées, testament de vie) de celles qui ont fait l’objet d’une décision médicale. La temporalité des limitations thérapeutiques (à l’admission versus en cours d’hospitalisation) n’est pas non plus établie eu égard au design rétrospectif de l’étude.
Implications et conclusions :
Les auteur·ices montrent une disparité du recours aux supports d’organe en réanimation selon le sexe, déjà démontrée dans plusieurs études, les femmes recevant moins de supports d’organe, à l’exception de l’ECMO.
Les facteurs explicatifs sur le moindre recours aux techniques de support d'organe proposés par les auteur·ices sont :
- Un biais de diagnostic des pathologies rencontrées en défaveur des femmes. Cependant, leur sévérité à l'admission en réanimation était plus faible, ce qui aurait pu faciliter une surveillance renforcée et un traitement non invasif.
- Un potentiel biais cognitif justifiant la préférence d’un traitement « conservateur » chez les femmes, et les limitations thérapeutiques, elles-mêmes le privilégiant parfois.
- Un recours à des décisions de placer les patient·es sous support d'organe dicté par des seuils physiologiques standardisés non adaptés au sexe féminin (par exemple taux d’urée conduisant à l’initiation d’une épuration extra-rénale).
Malgré le plus faible recours aux techniques invasives, la mortalité chez les femmes est plus faible. Cela pourrait être lié à leur mortalité plus faible dans le groupe ne recevant pas de support d’organe, évoquant le fait que l’approche « less is better » pourrait s’avérer bénéfique dans les deux populations, mais privilégiée chez les femmes. Cette hypothèse ne peut être confirmée sur la base du design rétrospectif de l’étude, mais plusieurs études supportent cette approche en soins critiques. Les patient·es bénéficiant d’un ou plusieurs supports d’organe ont en revanche une mortalité équivalente à celle des hommes.
Cette étude est un argument pour analyser séparément les patient·es dans les essais contrôlés randomisés en fonction de leur sexe, afin d'apprécier l'utilité des interventions pour chaque groupe.
Références cités dans les commentaires
- Todorov A, Kaufmann F, Arslani K, et al.; Swiss Society of Intensive Care Medicine: Gender differences in the provision of intensive care: A Bayesian approach. Intensive Care Med. 2021; 47:577–587
- Danziger J, Angel Armengol de la Hoz M, Li W, et al.: Temporal trends in critical care outcomes in U.S. minority-serving hospitals. Am J Respir Crit Care Med. 2020; 201:681–687
- Zettersten E, Jaderling G, Bell M, et al.: A cohort study investigating the occurrence of differences in care provided to men and women in an intensive care unit. Sci Rep. 2021; 11:23396
- Modra LJ, Higgins AM, Abeygunawardana VS, et al.: Sex differences in treatment of adult intensive care patients: A systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2022; 50:913–923
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Article commenté par Sofia Ortuno1 MD, Julien Le Marec2, MD, pour le groupe FEMMIR de la SRLF
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Envoyez vos commentaires/réactions à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
C. DUPUIS
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
G. FOSSAT
N. HIMER
T. KAMEL
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
V. ZINZONI