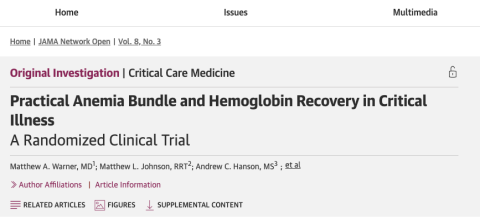
Warner MA, Johnson ML, Hanson AC, Fortune E, Flaby GW, Schulte PJ, Hazelton VM, Go RS, Beam WB, Charnin JE, Anderson BK, Karon B, Cheville AL, Gajic O, Kor DJ. Practical Anemia Bundle and Hemoglobin Recovery in Critical Illness: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2025 Mar 3;8(3):e252353. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.2353. PMID: 40152861; PMCID: PMC11953759.
Question évaluée :
Évaluer la faisabilité d’appliquer un ensemble de mesures préventives et curatives de l’anémie chez des patients de réanimation jusqu’à la sortie de l’hôpital en comparant l’hémoglobine à 1 mois entre patients ayant reçu l’intervention et ceux sans intervention.
Type d’étude :
Essai randomisé contrôlé monocentrique de phase II conduit aux Etats-Unis.
Population étudiée :
Patients majeurs admis en réanimation présentant une anémie modérée à sévère, définie par une hémoglobine inférieure à 10 g/dL.
Les critères de non inclusion étaient : une anémie sévère <9g/dL précédant l’hospitalisation, une transfusion de plus de 10 culots de globules rouges (CGR) dans les 48 heures précédentes, l’administration de fer en intra-veineux ou d’érythopoïétine dans les 30 jours précédents, l’impossibilité de participer au suivi, la grossesse, un infarctus du myocarde non revascularisé, un accident vasculaire cérébral dans les 3 mois, la nécessité d’assistance circulatoire extra-corporelle, l’absence de prophylaxie thromboembolique veineuse hors contexte de saignement actif ou de chirurgie récente et un sepsis avec une antibiothérapie adaptée de moins de 48 heures ou non contrôlé. Les patients présentant des critères de non inclusion modifiables (par exemple : sepsis, assistance circulatoire extra-corporelle) étaient réévalués chaque jour et pouvaient être inclus quand ils ne présentaient plus le facteur de non inclusion.
Méthode :
Essai randomisé contrôlé monocentrique de phase 2 en ouvert conduit à la Mayo Clinic (USA). Les patients éligibles étaient randomisés avec un ratio de 1:1 et une stratification selon l’étiologie de l’anémie (décrite en « pouvant répondre à une supplémentation en fer » ou « non répondant à une supplémentation en fer ») et selon le type d’admission (médicale ou chirurgicale) était réalisée. La réponse anticipée à une supplémentation en fer était définie par l’association (1) d’une anémie aiguë par perte sanguine secondaire à une hémorragie majeure (c’est-à-dire une perte sanguine aiguë >500 mL associée à une diminution de l’hémoglobine >2 g/dL ou nécessitant une intervention chirurgicale ou procédurale pour le contrôle de l’hémorragie), (2) d’une ferritinémie inférieur à 100 ng/mL, ou une saturation de la transferrine inférieure à 20 %.
L’intervention consistait à un ensemble de mesures de prévention et traitement de l’anémie et avait 3 composantes : (1) une optimisation des prélèvements sanguins (prélèvements de faibles volume, regroupement des examens dans le temps, utilisation d’un système fermé de prélèvements qui étaient effectués par une équipe dédiée, indépendante des équipes cliniques ou de recherche) ; (2) un soutien à la décision clinique pour réduire les perte sanguines, éviter l’hémodilution et les carences nutritionnelles ; (3) un traitement pharmacologique de l’anémie par administration de 1000 mg de fer dextran IV immédiatement après l’inclusion chez les patients ayant une anémie « pouvant répondre à une supplémentation en fer », ou par 40 000 unités d’érythropoïétine par voie sous-cutanée chez les patients considérés avec une anémie inflammatoire (associée à du fer IV si la ferritine était <1000 ng/mL).
Les patients du groupe contrôle recevaient une prise en charge habituelle, à la discrétion de l’équipe clinique, pendant toute la durée de l’hospitalisation. Des traitements pharmacologiques de l’anémie dont le fer IV, pouvaient être utilisés s’ils étaient considérés comme faisant partie de la pratique clinique habituelle.
La stratégie transfusionnelle en CGR recommandée étaient identiques dans les 2 groupes avec un seuil transfusionnel de 7 g/dL d’hémoglobine, ou de 8 g/dL chez les patients présentant une ischémie coronarienne ou des apports tissulaires en oxygène insuffisants.
Les participants et les soignants connaissaient le groupe de randomisation, mais les personnes responsables de recueillir les critères de jugement ainsi que les statisticiens ne le connaissait pas.
Le critère de jugement principal était la différence moyenne du taux d’hémoglobine à 1 mois et à 3 mois de la sortie d’hospitalisation, ainsi qu’à la sortie de la réanimation et de l’hôpital.
Les critères de jugement secondaires, évalués à 1 mois et à 3 mois, incluaient : la qualité de vie selon l’échelle EQ-5D, la fatigue (mesurée avec FACIT Subscale), l’aptitude physique évaluée par la distance de marche de 6 minutes et le score Katz-ADL, les fonctions cognitives (mesurées avec le MOCA-Blind) et la santé mentale et l’anxiété (HADS). De plus, le taux de CGR transfusés, les hospitalisations non planifiées, la mortalité, la fréquence des phlébotomies, les volumes prélevés ainsi que le nombre de prélèvements ayant dû être refaits en raison d’une non-conformité initiale ont été comparés.
La taille de l’échantillon a été calculée pour détecter une différence absolue de 1 g/dL dans la concentration d’hémoglobine à 1 mois entre les groupes, avec une puissance de 80 % et un risque alpha bilatéral de 5 %. Le nombre total de participants requis était de 74, porté à 100 afin de compenser les potentiels perdus de vue. Les analyses étaient réalisées en intention de traiter.
Résultats essentiels :
Entre mars 2022 et novembre 2023, 100 patients ont été inclus (49 dans le groupe intervention et 51 dans le groupe contrôle). Leur âge médian était de 68 ans [61-72], 57% étaient des hommes. La plupart des patients étaient admis après chirurgie (65% dont 70.8% après chirurgie cardiaque). Parmi les admissions non chirurgicales, les causes cardiovasculaires étaient les plus fréquentes (16/35, soit 45.7%). L’hémoglobine médiane à la randomisation était égale à 8.9 g/dl (8.4-9.4) et comparable dans les deux groupes. Tous les patients avaient une anémie « pouvant répondre au traitement par fer ». Aucun patient n’a reçu d’érythropoïétine. Tous les patients dans le groupe intervention ont reçu du fer (mais un patient a uniquement reçu 500 mg) versus 6/51 (11.8%) dans le groupe contrôle.
L’hémoglobine médiane à un mois de la sortie de l’hôpital était plus élevée chez les 49 patients du groupe intervention en comparaison à celle des 51 patients du groupe contrôle (12.2 [11.8-13.0] g/dL vs. 11.5 [10.2-12.6] g/dL; différence moyenne de 0.69 [95%CI, 0.13-1.20] g/dL; p=0.02). Des résultats similaires étaient retrouvés à 3 mois mais pas à la sortie de réanimation ni de l’hôpital.
Concernant les critères de jugement secondaires, il n’y avait aucune différence significative entre les deux groupes, à l’exception d’un nombre plus important de patients avec un syndrome post traumatique à trois mois dans le groupe interventionnel, sans probable rapport de causalité avec l’intervention. Il y a eu moins de patients transfusés en CGR à 3 mois (1 patient (2%) vs 6 patients (11.8%) ; p=0.09) et moins de patients exposés aux phlébotomies pendant l’hospitalisation (en fréquence et en volume) dans le groupe interventionnel. Les patients dans le groupe interventionnel avaient des scores de fatigue plus bas à 3 mois (OR, 2.52; 95%CI, 0.88-7.20; p=0.08). La mortalité était comparable, de 4.1% et de 2% dans le groupe interventionnel et contrôle, respectivement.
Il n’y avait pas de différence en termes d’évènements indésirables, tous considérés comme non liés aux procédures de l’étude.
Commentaires :
Cette étude de faisabilité montre que l’instauration de mesures de prévention et de traitement de l’anémie chez les patients de réanimation jusqu’à leur sortie de l’hôpital est possible et efficace sur le taux d’hémoglobine à 1 et 3 mois. L’amélioration observée de l’hémoglobine suggère un bénéfice biologique, dont la relevance clinique reste à démontrer.
Cette étude met en avant l’importance d’associer des mesures préventives et curatives de l’anémie acquise à l’hôpital. L’utilisation des tubes de faible contenance, dans un essai multicentrique en cluster, a déjà rapporté un intérêt sur le recours à la transfusion de CGR [2] et devrait être le « standard of care » chez nos patients, de même qu’une presciption réfléchie des examens complémentaires dont le bénéfice sur le nombre et donc le volume de prélèvements a déjà été rapporté depuis longtemps [3].
En revanche, la population de l’étude (principalement post opératoire ou un motif cardiovasculaire, avec une très faible mortalité et une courte durée de séjour) et le moment d’administration du fer (la veille de la sortie de réanimation) ne nous permettent pas d’extrapoler les résultats de cette étude à la phase aigue de la prise en charge des patients de réanimation. Ce travail ne réponds donc pas à la question du traitement curatif de l’anémie en réanimation. Le fer en post-opératoire est déjà recommmendé par l’HAS pour les patients n’en ayant pas reçu en préopératoire et ayant une carence martiale [4]. Son bénéfice, en association à l’EPO, sur le taux d’hémoglobine a notamment été rapporté après chirurgie cardiaque chez les patients présentant une carence martiale [5].
Cette étude rappel des résultats déjà rapportés sur l’impact du fer sur le taux d’hémoglobine chez des patients sortants de réanimation et présentant une carence martiale [6]. La place de l’EPO dans ce contexte reste indéterminée.
Points forts :
Problématique fréquente en réanimation et associée au pronostic.
Approche pragmatique et, en partie, transposable à la pratique quotidienne.
Personnalisation des mesures thérapeutiques avec identification des patients ayant une carence martiale avérée ou très probable, et ceux ayant une anémie inflammatoire guidant ainsi l’administration de fer et d’EPO.
Prise en soin multifactorielle de l’anémie avec association de mesures préventives réduisant la spoliation sanguine et de mesures curatives.
Intégration de critères de jugement sur les capacités fonctionnelles physiques et cognitives et la qualité de vie.
Application des mesures de prévention après la sortie de réanimation.
Analyse statistique rigoureuse et bien conduite, avec une utilisation appropriée des méthodes d’analyse en intention de traiter et des modèles ajustés.
Protocole de l’étude publié avant le début de l’étude [1].
Points faibles :
Etude monocentrique limitant la validité externe.
Etude de faisabilité (étude pilote) non prévue en terme de taille d’échantillon pour évaluer des critères de jugements centrés sur le patient, ni la tolérance notamment du fer IV dextran (formulation associée à un risque anaphylactique)
Étude en ouvert pour les participants et les cliniciens.
Patients essentiellement post chirurgicaux et peu sévères restant en médiane 1 jour en réanimation (IQR 0-2) après randomisation, questionnant la généralisation des mesures curatives de l’anémie aux patients de réanimation plus sévères.
Relevance clinique de la différence moyenne d’hémoglobine (0.69 g/dl) pour des taux d’hémoglobine proche de la normale (à 1 mois) ou normaux (> 13g/dL à 3 mois).
Considère a priori l’indication de l’EPO sur des critères pas complètement standardisés
Le nombre de prélèvements dans le groupe standard est très élevé (142 ml/hospitalisation pour une durée médiane de 6 jours correspondant à 35 prélèvements de 4 ml soit quasiment 5.8 tubes / jour par patient).
Équipe de prélèvements dédiée et indépendante de l’équipe de soins, difficile à transposer à d’autres pays.
Implications et conclusions :
Le protocole de cette étude combine des mesures préventives et curatives non transfusionnelles personnalisées de l’anémie. Les résultats mettent en évidence un bénéfice modeste mais significatif sur la récupération de l’hémoglobine à un et trois mois. En revanche, l’effet sur les critères fonctionnels reste indéterminé compte tenu du manque de puissance. Alors que les mesures préventives de l’anémie devraient être le « standard of care », le schéma de l’étude ainsi que la population ne permettent pas d’adopter les mesures curatives non transfusionnelles pour tous les patients de réanimation.
Des études de plus grande ampleur sont nécessaires pour mieux évaluer l’impact clinique de cette stratégie personnalisée curative de l’anémie et mieux définir les patients pouvant en bénéficier.
Références cités dans les commentaires :
- Warner MA, Go RS, Schulte PJ, et al (2022) Practical Anemia Bundle for Sustained Blood Recovery (PABST-BR) in critical illness: a protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open 12:e064017. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-064017
- Siegal DM, Belley-Côté EP, Lee SF, et al (2023) Small-Volume Blood Collection Tubes to Reduce Transfusions in Intensive Care: The STRATUS Randomized Clinical Trial. JAMA 330:1872–1881. https://doi.org/10.1001/jama.2023.20820
- Prat G, Lefèvre M, Nowak E, et al (2009) Impact of clinical guidelines to improve appropriateness of laboratory tests and chest radiographs. Intensive Care Med 35:1047–1053. https://doi.org/10.1007/s00134-009-1438-z
- Haute Autorité de Santé (HAS). Recommandations pour la mise en œuvre d’une stratégie d’optimisation de la gestion du sang du patient (Patient Blood Management - PBM) [Internet]. Saint-Denis La Plaine : HAS ; 2022 [consulté le 24 juin 2025]. Disponible à : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/recommandations_pbm_mel.pdf
- Saour M, Blin C, Zeroual N, et al (2024) Impact of a bundle of care (intravenous iron, erythropoietin and transfusion metabolic adjustment) on post-operative transfusion incidence in cardiac surgery: a single-centre, randomised, open-label, parallel-group controlled pilot trial. Lancet Reg Health Eur 43:100966. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100966
- IRONMAN Investigators, Litton E, Baker S, et al (2016) Intravenous iron or placebo for anaemia in intensive care: the IRONMAN multicentre randomized blinded trial : A randomized trial of IV iron in critical illness. Intensive Care Med 42:1715–1722. https://doi.org/10.1007/s00134-016-4465-6
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Commenté par : Kahaia de LONGEAUX et Cécile AUBRON, Médecine intensive et réanimation, CHU de Brest, France.
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Voir les déclarations de conflits d'intérêt (titre cliquable): Kahaia de LONGEAUX
Envoyez vos commentaires/réactions à kahaia.delongeaux@chu-brest.fr ; cecile.aubron@chu-brest.fr et à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
A.CAILLET
C. DUPUIS
N. FAGE
JP. FRAT
G. FOSSAT
A. GAILLET
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
N. HIMER
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
M. THY