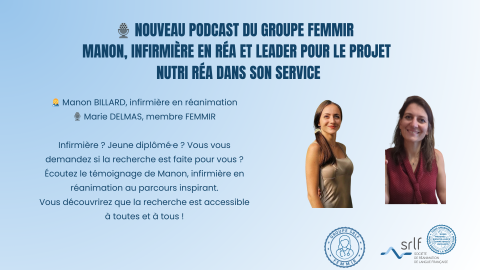La pratique de la médecine a longtemps été l’apanage des hommes et ce n’est que depuis quelques dizaines d’années que le nombre de femmes médecins a augmenté pour atteindre aujourd’hui une globale parité [1]. Néanmoins, en dépit de cette évolution positive, un constat s’impose au quotidien : dans le domaine de la médecine et, de manière plus spécifique de la réanimation, les femmes n’ont toujours pas une place équivalente à celle des hommes.
En 2023, 63% des candidats aux ECN étaient des candidates [2]. En 20123, le relevé démographique du Conseil National de l’Ordre des Médecins relevait que les femmes représentaient 48,8% des médecins en activité [3]. Pourtant, elles ne représentaient en 2022 que 24,1% des Professeur-es des universités – Praticien-nes hospitalier-es (PU-PH) [4], 18% des chef-fes de service hospitalier et seulement 13% des doyen-nes de faculté [5]. Pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de femmes invitées dans les médias en tant qu’expertes était extrêmement réduit [6].
Cette inégalité de représentation au sein des postes à responsabilité s’accompagne au quotidien de violences et de discriminations de genre. Selon le Baromètre IPSOS-Donner des Elles à la Santé, plus de 8 femmes sur 10 dans le milieu hospitalier se sont déjà senties discriminées au cours de leur carrière du fait de leur genre, plus de ¾ ont été victimes de comportements sexistes, et 30% déclarent avoir subi des gestes inappropriés à connotation sexuelle ou des agressions sexuelles[5].
Ces inégalités de genre et ces violences subies par les femmes sont retrouvées au-delà de notre spécialité et de notre pays : de nombreuses publications internationales récentes font état de différences de traitement des femmes par rapport aux hommes dans tous les domaines de la pratique médicale et de la recherche [7–14].
Et alors, dans notre spécialité ?
L’enquête du Collège des Enseignants en Médecine Intensive et Réanimation (CEMIR) publiée en 2021 et portant sur la démographie des services de réanimation en France montrait que les femmes représentent 31% des réanimateurs en activité. Ce chiffre tend à s’équilibrer vers la parité pour les classes d’âge de moins de 40 ans [15], et parmi les internes ayant choisi la spécialité Médecine Intensive et Réanimation (MIR) en 2023, 49,6% étaient des femmes [16].
Bien qu’étant de plus en plus nombreuses, les réanimatrices sont toujours extrêmement sous-représentées au sein des postes décisionnaires, dans le milieu de la recherche ou dans les médias. Moins de 10% des Professeurs des Universités-Praticiens Hospitaliers (PU-PH) en 2022 en MIR étaient des femmes [4]. L’enquête démographique du CEMIR montrait que les femmes représentaient 12% des chefs de service [15]. En 2018, elles représentaient 20% des membres de commissions de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) et 16% des orateur-ices au congrès annuel de la SRLF.
Concernant les discriminations, les chiffres évoqués plus haut sont retrouvés au sein de la spécialité MIR : 55% des réanimatrices déclarent avoir subi des discriminations en raison de leur genre sur leur lieu de travail, et 37% avoir été victime de harcèlement, notamment sexuel [17].
C’est dans ce contexte que le groupe FEMMIR (Femmes Médecins en MIR) a été créé en juin 2019. Composé de 14 membres (12 femmes et 2 hommes), notre groupe a pour objectif d’étudier la situation des femmes au sein de notre spécialité et de proposer des actions afin d’atteindre l’égalité et de lutter contre les discriminations et les violences.
Références :
- Lapeyre N, Le Feuvre N (2005) Féminisation du corps médical et dynamiques professionnelles dans le champ de la santé. Rev Fr Aff Soc 59–81.
- Épreuves Classantes Nationales (ECN) (2022). Le CNG.
https://www.cng.sante.fr/candidats/internats/concours-medicaux/etudiants/epreuves-classantes-nationales-ecn - La démographie médicale. (2023) Conseil National de l'Ordre des Médecins.
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/analyse_etude/b6i7b6/cnom_atlas_demographie_2023.pdf - Denépoux K (2023) Égalité femmes-hommes. Le CNG.
https://www.cng.sante.fr/cng/egalite-femmes-hommes - Nos actions - Donner des ELLES à la santé - Egalité Femmes-Hommes. https://www.donnerdesellesalasante.org
- BLOG - “Après 5 vagues de Covid-19, les femmes réanimatrices toujours absentes des médias.” (2022) Le HuffPost.
https://www.huffingtonpost.fr/medias/article/apres-5-vagues-de-covid-19-les-femmes-reanimatrices-toujours-absentes-des-medias_190736.html - 7. Viglione G (2020) Are women publishing less during the pandemic? Here’s what the data say. Nature 581:365–366. DOI : 10.1038/d41586-020-01294-9
- Vranas KC, Ouyang D, Lin AL, et al (2020) Gender Differences in Authorship of Critical Care Literature. Am J Respir Crit Care Med 201:840–847. DOI : 10.1164/rccm.201910-1957OC
- Chatterjee P, Werner RM (2021) Gender Disparity in Citations in High-Impact Journal Articles. JAMA Netw Open 4:e2114509. DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2021.14509
- Bedi G, Dam NTV, Munafo M (2012) Gender inequality in awarded research grants. The Lancet 380:474. DOI : 10.1016/S0140-6736(12)61292-6
- Pinho-Gomes A-C, Vassallo A, Thompson K, et al (2021) Representation of Women Among Editors in Chief of Leading Medical Journals. JAMA Netw Open 4:e2123026. DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2021.23026
- Ha GL, Lehrer EJ, Wang M, et al (2021) Sex Differences in Academic Productivity Across Academic Ranks and Specialties in Academic Medicine: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open 4:e2112404. DOI : 10.1001/jamanetworkopen.2021.12404
- Mehta S, Rose L, Cook D, et al (2018) The Speaker Gender Gap at Critical Care Conferences. Crit Care Med 46:991. DOI : 10.1097/CCM.0000000000003114
L’objectif de notre groupe était d’abord de faire l’état des lieux de la situation des femmes au sein de la spécialité : nous avons mené une enquête auprès de l’ensemble des réanimatrices membres de la SRLF, qui a fait l’objet d’une publication scientifique et sert depuis de base à nos travaux. Une fois ces constations faites, nos projets et objectifs sont nombreux :
- Poursuivre le travail de représentation et d’amplification de la voix des femmes dans la spécialité.
- Atteindre la parité et l’équité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances de notre spécialité (SRLF, congrès, journaux…).
- Promouvoir la recherche (médicale et paramédicale) par les femmes et sur les femmes patientes. Le groupe FEMMIR conduit ses propres projets de recherche et porte des initiatives d’incitation à la recherche (formations, travail en réseau…).
- Faire évoluer les organisations afin de les adapter au mieux à une qualité de vie personnelle équilibrée pour toutes et tous. Inciter à une prise en compte de la parentalité dans les organisations de service (congé maternité / paternité, allaitement…). Lutter contre le sexisme dit « ordinaire » (qui, rappelons-le, est interdit par la loi) dans les relations professionnelles.
- Développer un travail coopératif en réseau avec des femmes réanimatrices et d’autres spécialités, avec des femmes de la fonction publique non hospitalière, et à l’international.
- S’engager en faveur de l’inclusivité au-delà du genre, et lutter contre toutes les discriminations et violences, notamment à l’égard des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBTQ+, des personnes en situation de handicap.
- Améliorer l’attractivité de la Médecine Intensive Réanimation pour les jeunes médecins, par la mise en œuvre des objectifs ci-dessus, et par des formations en 3ème cycle en partenariat avec le CeMIR.
Secrétaire :
Agathe Béranger
PH, Service de Réanimation Médico-Chirurgicale Pédiatrique, CHU Necker Enfants Malades
Secrétaire Adjointe :
Justine Cibron
Service de Médecine Intensive Réanimation, CHU de Tours
Membres :
- Joêlle Beaudet
PH, Service de Réanimation pédiatrique, CHU de Reims - Alexandra Beurton
PH, Service Médecine Intensive Réanimation (R3S), Hôpital Universitaire La Pitié-Salpêtrière, Paris - Marie Delmas
IDE, Service de Réanimation Polyvalente - Soins continus - CH d'Albi - Julien Dessajan
CCA, Service de Réanimation Médicale et Infectieuse - HUPNVS - Hôpital Bichat - Claude-Bernard - Marion Giry
CCA, Service de Réanimation Médicale - CHU de Rouen - Hôpital Charles Nicolle - Adeline Grateau
PH, Réanimation, CHU de St Denis de la Réunion - Mariana Jorge
Service de Réanimation, CH de Rambouillet - Clémence Marois
PH, Service de Neurologie et Réanimation - Hôpital Universitaire La Pitié-Salpêtrière - Hela Maamouri
PH, Service de Réanimation - CH de Rambouillet - Sofia Ortuno
PH, Pôle Réanimation, Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Francesca Santi
PH, Service de Réanimation Adulte, CHI de Créteil - Chantal Sevens
Ancienne Directrice de la SRLF, Paris - Nicolas Terzi
PUPH, Service de Médecine Intensive Réanimation, CHU de Rennes
Membres invitées :
- Margaux Terrou
Cofondatrice de HER’OES and associates – Conseil en égalité professionnelle - Agathe Terrou
Cofondatrice de HER’OES and associates – Conseil en égalité professionnelle
Membres associé.es :
- Caroline Hauw-Berlemont
PH, Service de Médecine intensive réanimation, Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP)
Le réseau :
En plus du groupe, le réseau FEMMIR se constitue de femmes réanimatrices qui souhaitent se joindre au projet, qui peuvent partager leurs idées, élargir la vision du groupe et accroître significativement son impact. Chacune pourra si elle le souhaite s’investir dans des missions ponctuelles.
Le réseau recevra les compte-rendus des réunions mensuelles du groupe, se réunira une fois par trimestre par video call
Si vous souhaitez rejoindre le réseau, vous pouvez nous contacter ici (femmir@srlf.org)
Parité
Grâce à l’action du FEMMIR, la parité au sein des commissions et du conseil d’administration de la SRLF est devenue la règle. Afin d’obtenir l’équilibre, des postes à priorisation féminine ont été créés. Nous y sommes presque : à l’issue des élections 2023, l’ensemble des commissions de la SRLF se composait de 69 femmes pour 75 hommes.
Cet objectif s’étend aussi au congrès annuel de la SRLF : petit à petit, nous nous approchons de la parité autant parmi les intervenant-es que parmi les modérateur-ices.
Liste d’expertes
Afin d’améliorer la visibilité des femmes médecins et chercheuses en réanimation et de faire connaître leur travail, au sein des congrès, du monde de la recherche ou des médias, nous avons mis en place une liste d’expertes. Elle est régulièrement mise à jour, et mise à disposition des réanimateur.ices, des organisateur-ices de congrès, formations et éditeur-ices de journaux médicaux, et des journalistes.
Publications
Le groupe FEMMIR est à l’origine de plusieurs publications scientifiques[LMJ1] . Plusieurs projets de recherche sont également en cours, s’intéressant notamment aux femmes patientes, aux violences chez les patientes, à la qualité de vie et de travail des médecins réanimateur-ices ou encore aux différences de genre parmi les orateur-ices de congrès.
Enseignement
Le FEMMIR organise chaque année un enseignement aux internes de phase socle de MIR concernant les inégalités femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles. Depuis 2023, un enseignement est également dispensé aux internes de phase d’approfondissement, sur les thématiques des biais de genre, et plus largement aux discriminations et biais inconscient à l’égard des patient-es (grossophobie, psychophobie, racisme…).
Par ailleurs, chaque année, des formations certifiées Qualiopi sont organisées par le FEMMIR à destinations des soignant-es de réanimation.
Réseaux
Par-delà les membres du groupe, le FEMMIR s’appuie sur un réseau de plus de 60 réanimateur-ices, dont les membres peuvent s’associer aux projets du groupe, proposer des projets, diffuser des informations ou des propositions de recherche… Les projets et travaux du groupe FEMMIR s’inscrivent également au sein d’une réflexion plus globale trans-disciplinaire, afin de mener en commun des actions concernant toutes les spécialités (par exemple autour de la parentalité). Des réunions interpsécialités sont régulièrement organisées. Nous sommes régulièrement en contact avec nos consœurs et confrères Europén-nes sensibilisé-es à ces thématiques au sein du réseau iWin. Nous travaillons également avec des groupes de femmes de la fonction publique non hospitalière.
- Le groupe FEMMIR : du constat aux actions pour l’égalité femmes-hommes en réanimation.
Le Marec, J., Beaudet, J., Beurton, A., Boissier, F., Cibron, J., Faure, M., Grateau, A., Jorge, M., Ortuno, S., Salmon Gandonnière, C., Santi, F., Sevens, C., Terzi, N., & Béranger, A. (2024). Médecine Intensive Réanimation, 33(Hors-série 1), 69–74. https://doi.org/10.37051/mir-00228 -
Sex disparities in cardiogenic shock: Insights from the FRENSHOCK registry.
Manzo-Silberman S, Martin AC, Boissier F, Hauw-Berlemont C, Aissaoui N, Lamblin N, Roubille F, Bonnefoy E, Bonello L, Elbaz M, Schurtz G, Morel O, Leurent G, Levy B, Jouve B, Harbaoui B, Vanzetto G, Combaret N, Lattucca B, Champion S, Lim P, Bruel C, Schneider F, Seronde MF, Bataille V, Gerbaud E, Puymirat E, Delmas C; FRENSHOCK investigators.
J Crit Care. 2024 Mar 16;82:154785. doi: 10.1016/j.jcrc.2024.154785
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38493531/ -
Ten actions to achieve gender equity among intensivists: the French Society of Intensive Care (FICS) model.
Olfa Hamzaoui, Florence Boissier, Charlotte Salmon Gandonnière, Cécile Aubron, Laetitia Bodet-Contentin, Muriel Sarah Fartoukh, Mélanie Faure, Mercedes Jourdain, Julien Le Marec, Fabienne Tamion, Nicolas Terzi, Caroline Hauw-Berlemont, Nadia Aissaoui, FEMMIR group for the SRLF trial group.
Ann Intensive Care. 2022 Jul 2;12(1):59. doi:10.1186/s13613-022-01035-3. - Tribune : Après 5 vagues de Covid-19, les femmes réanimatrices toujours absentes des médias.
Par le groupe FEMMIR, HuffPost du 04/01/2022 - Gender imbalance in intensive care: High time for action and evaluation!
Hauw-Berlemont C, Salmon Gandonnière C, Boissier F, Aissaoui N, Bodet-Contentin L, Fartoukh MS, Jourdain M, Le Marec J, Tamion F, Hamzaoui O, Aubron C; FEMMIR (Femme Médecins en Médecine Intensive Réanimation) Group for the French Intensive Care Society.
Crit Care. 2021 Jul 7;25(1):239. doi: 10.1186/s13054-021-03657-8. - Perceived inequity, professional and personal fulfillment by women intensivists in France.
Hauw-Berlemont C, Aubron C, Aissaoui N, Bodet-Contentin L, Boissier F, Fartoukh MS, Jourdain M, Le Marec J, Pestel J, Salmon Gandonnière C, Tamion F, Hamzaoui O; FEMMIR Group for the SRLF Trial Group
Ann Intensive Care. 2021 May 12;11(1):72. doi: 10.1186/s13613-021-00860-2.

Perceived inequity, professional and personal fulfillment by women intensivists in France
21/05/2021

35 ans plus tard, les inégalités universitaires homme/femme n’ont pas pris une ride !
05/05/2021
Nous pensons qu’il est important de prendre connaissance des recherches faites en matière de parité au sein de la Médecine. En effet, c’est un sujet sur lequel de nombreuses équipes se sont interrogées lors de la dernière décennie et des manuscrits ont été publiés dans les revues scientifiques médicales les plus prestigieuses.
Le but de cette section est de faire prendre conscience qu’il s’agit d’un sujet important et qui peut être évalué objectivement, loin des débats partisans que cette thématique peut engendrer.
En réanimation
Sex differences and anti-epidemic work in psychological symptoms of healthcare workers in intensive care units during the COVID-19 pandemic: a nationwide cross-sectional study - PubMed
Zeng LN et al. BMJ Open Aug 2025Are We There Yet? Equity in the Pulmonary and Critical Care Medicine Fellowship Application Process - PMC
Mohanraj, E Mirna. ATS scholar Mar 2025Gender Inequity in Institutional Leadership Roles in US Academic Medical Centers: A Systematic Scoping Review - PMC
Levy, Morgan S et al. JAMA network Apr. 2025Women Physicians in Leadership Roles in Critical Care Medicine or Academic Medicine—A Systematic Literature Review - PMC
Siddiqui, Shahla et al. Critical care explorations Mar. 2025Gender imbalance in critical care medicine journals - PubMed
Santonocito C et al. Anaesth Crit Care Pain Med. May 2025Gender equity in Critical Care Medicine. How much have we progressed? - PMC
Soares Lanziotti, Vanessa et al. Critical care science Apr. 2025Female first and senior authorship in high-impact critical care journals 2005–2024 | Critical Care | Full Text
Bruns, N. et al. Crit Care Sep 2025Factors associated with women authorship over 25 years in high-impact critical care randomized controlled trials: the pipeline is still leaking | Critical Care | Full Text
Pensier, J. et al. Crit Care Aug 2025Gender equality in research publishing is a responsibility for everyone
No author listed Nature Jun 2025Surgeon Sex and Long-Term Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Common Surgeries - PubMed
Wallis CJD et al. JAMA Surg. Nov 2023Gender differences in career satisfaction, moral distress, and incivility: a national, cross-sectional survey of Canadian critical care physicians | Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie
Burns, Karen E A et al.Canadian journal of anaesthesia 2019
https://link.springer.com/article/10.1007/s12630-019-01321-yRape-Related Pregnancies in the 14 US States With Total Abortion Bans.
Dickman et al., JAMA internal med, 24 janvier 2024
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2814274The effects of gender discrimination on medical students' choice of specialty for their (junior) residency - a survey among medical students in Germany
Stock et al., BMC Med Educ, mai 2024
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38816875/Incidence of sexual violence among recently arrived asylum-seeking women in France: a retrospective cohort study.
Khouani et al., Lancet Regional Health Europe, 17/09/2023
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(23)00150-3/fulltextSex and gender differences in intensive care medicine
Merdji et al., Intensive Care Medicine, 07/09/2023
https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-023-07194-6Gender and racial differences in first and senior authorship of high-impact critical care randomized controlled trial studies from 2000 to 2022.
Chander et al., Annals of Intensive Care, juillet 2023.
https://annalsofintensivecare.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/s13613-023-01157-2.pdfHealth effects associated with exposure to intimate partner violence against women and childhood sexual abuse: a Burden of Proof study
Spencer et al., Nature, décembre 2023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10719101/Women’s autonomy in healthcare decision making: a systematic review.
Idayu Badilla et al., BMC Women’s Health, décembre 2023
https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-023-02792-4Gender Gap in Leadership of Clinical Trials.
Waldhorn et al., JAMA Internal Medicine, octobre 2023
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2811101The Lancet Commission on peaceful societies through health equity and gender equality.
Percival et al., The Lancet, septembre 2023.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01348-X/fulltextImpostor syndrome in anaesthesiology primarily affects female and junior physicians.
Gisselbaek et al. British Journal of Anesthesia, décembre 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37884406/Medical colleges and unions call for inquiry over “shocking” levels of sexual assault in the NHS.
BMJ, 23 mai 2023
https://www.bmj.com/content/381/bmj.p1105Gender and racial differences in first and senior authorship of high‑impact critical care randomized controlled trial studies from 2000 to 2022.
Chander et al., AIC, juin 2023.
https://www.springeropen.com/epdf/10.1186/s13613-023-01157-2?sharing_token=u6zxx1kJnJZ23v1TpElrAG_BpE1tBhCbnbw3BuzI2RM2b3i30ZCqCbT8Ty6lrgJAQjMh8t8vaedQgN1WRCsfmkgQc0J75iRNUo36EmC-tY8kfpsTXa2FeTPVZ0nSGmBLuLpqCrEEjr8P02gZhpCbmigticmzInbaADdvLOFRQC4%3DGender and racial differences in first and senior authorship of high-impact critical care randomized controlled trial studies from 2000 to 2022.
Chander et al., AIC, juin 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37368060/Gender distribution of editorial board members in critical care journals: Assessment of gender parity.
Yakar et al., J Crit Care, juin 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36934041/Gender disparity in prestigious speaking roles: A study of 10 years of international conference programming in the field of gambling studies.
Monson et al. Plos One, juin 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37347772/Gender Discrimination and Mental Health Among Health Care Workers: Findings from a Mixed Methods Study.
Hennein et al., J Womens Health (Larchmt), juillet 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37256783/Interpersonal Interactions and Biases in Orthopaedic Surgery Residency: Do Experiences Differ Based on Gender?
Sobel et al., Clin Orthop Relat Res, feb 2022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36668700/Gender-related differences in career development among gynecologic oncology surgeons in Europe. European Network of Young Gynecologic Oncologists’ Survey based data.
Nikolova et al., Front Oncol, dec 2022
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2022.1005130/fullWomen Authorship Trends in the Highest-Impact Anesthesiology Journals from 2005 to 2021,
Keim et al, J Womens Health (Larchmt), jan 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36637854/Gender discrimination among women healthcare workers during the COVID-19 pandemic: Findings from a mixed methods study,
Hennein et al., Plos One, feb 2023
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281367Comparison of Male and Female Surgeons’ Experiences With Gender Across 5 Qualitative/Quantitative Domains,
Zogg et al., JAMA Surgery, jan 2023
https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2799390High Infertility Rates and Pregnancy Complications in Female Physicians Indicate a Need for Culture Change
Lai et al., Ann Surg, March 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36250327/Addressing gender imbalance in intensive care.
Vincent JL, et al.
Crit Care. 2021 Apr 16;25(1):147.Gender imbalance in intensive care: High time for action and evaluation
Hauw-Berlemont C, et al.
Crit Care. 2021 Jul 7;25(1):239.Perceived inequity, professional and personal fulfillment by women intensivists in France.
Hauw-Berlemont C, et al.
Ann Intensive Care. 2021 May 12;11(1):72.Women in Anaesthesia and Intensive Care Medicine in France: Are we making any progress?
Godier A, et al.
Anaesth Crit Care Pain Med. 2020 Aug;39(4):507-511.Women in intensive care study: a preliminary assessment of international data on female representation in the ICU physician workforce, leadership and academic positions.
Venkatesh B, et al. Crit Care. 2018 Sep 10;22(1):211.Gender Differences in Authorship of Critical Care Literature.
Vranas K C, et al
Am J Respir Crit Care Med. 2020 Apr 1; 201 (7):840-847.The Speaker Gender Gap at Critical Care Conferences.
Mehta S, et al.
Crit Care Med.2018 Jun;46(6):991-996.
Et ailleurs
Impact de la crise COVID sur les femmes
Research Note: Gender Differences in Employment During the COVID-19 Epidemic.
Andrés Villarreal et al.
Demography. 2022Promoting Equity for Women in Medicine - Seizing a Disruptive Opportunity.
Jagsi R, et al.
N Engl J Med. 2021 Jun 17;384(24):2265-2267.Institutional imperatives for the advancement of women in medicine and science through the COVID-19 pandemic.
Salles A, et al.
Lancet. 2021 Sep 11;398(10304):937-939.Are women publishing less during the pandemic? Here’s what the data say.
Viglione G.
Nature. 2020; 581(7809):365-366.COVID-19 and the slide backward for women in academic medicine. Spector N, et al. JAMA Netw Open. 2020;3(9):e202106.
Impact du genre et statut universitaire et recherche
Impact of gender on self-assessment accuracy among fourth-year French medical students on faculty’s online Objective Structured Clinical Examinations - PMC
Bodard, Sylvain et al. BMC medical education Dec. 2024
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11684291/The gender gap in academic surgery: the electronic health record - PMC£Bessen, Sarah Y et al. BMC surgery Feb. 2025
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11869488/Sex Differences in Academic Productivity Across Academic Ranks and Specialties in Academic Medicine: A Systematic Review and Meta-analysis.
Ha GL, et al.
JAMA Netw Open. 2021 Jun 1;4(6):e2112404.Mentoring Relationships and Gender Inequities in Academic Medicine: Findings From a Multi-Institutional Qualitative Study.
Murphy M, et al.
Acad Med. 2021 Sep 7.American Association of Medical Colleges. The state of women in academic medicine: The pipeline and pathways to leadership. Washington, DC: AAMC, 2013-2014. Available at: https://www.aamc.org/members/gwims/statisticsAccessed December 5, 2019
Gender inequality in awarded research grants. Bedi G, et al 2012 Aug 4;380(9840):474.
Gender differences in grant peer review: a meta-analysis. Bornmann L, et al. J Informetr. 2007; 1(3): 226–238.
Addressing women’s under-representation in medical leadership. Boylan J, et al. Lancet. 2019 Feb 9;393(10171):e14.
Differences in research funding for women scientists: a systematic comparison of UK investments in global infectious disease research during 1997–2010. Head MG, et al. BMJ Open, 3 (2013), p. e003362.
Sex differences in academic rank in US medical schools in 2014. Jena AB, et al. JAMA. 2015 Sep 15;314(11):1149-1158.
Gender Differences in Academic Medicine: Retention, Rank, and Leadership Comparisons From the National Faculty Survey. Phyllis L. Carr, et al. Acad Med. 2018 Nov; 93(11): 1694–1699.
Funders should evaluate projects, not people. Raymond JL, et al. Lancet 2019 Feb 9;393(10171):494-495.
Are gender gaps due to evaluations of the applicant or the science? A natural experiment at a national funding agency. Witteman HO, et al. Lancet 2019 Feb 9;393(10171):531-540.
Women Physicians and Promotion in Academic Medicine. Richter KP, et al. N Engl J Med. 2020 Nov 26;383(22):2148-2157.
Gender Issues in Academic Hospital Medicine: a National Survey of Hospitalist Leaders. Herzke C, et al. J Gen Intern Med. 2020 Jun;35(6):1641-1646.
Grossesse et maternité
Incidence of Infertility and Pregnancy Complications in US Female Surgeons.
Rangel EL, et al.
JAMA Surg. 2021 Jul 28. doi: 10.1001/jamasurg.2021.3301Perspectives of US General Surgery Program Directors on Cultural and Fiscal Barriers to Maternity Leave and Postpartum Support During Surgical Training.
Castillo-Angeles M, et al. JAMA Surg. 2021 Jul 1;156(7):647-653Perceived Discrimination Experienced by Physician Mothers and Desired Workplace Changes: A Cross-sectional Survey. Adesoye T, et al. JAMA Intern Med. 2017 Jul 1;177(7):1033-1036
Gender differences in time spent on parenting and domestic responsibilities by high-achieving young physician-researchers. Jolly S, et al. Ann Intern Med.2014 Mar 4;160(5):344-53.
Sous-représentation des femmes dans les revues médicales et congrès
Analysis of authorship trends in vascular surgery demonstrates a sticky surgical floor for women.
Buda et al.
J Vasc Surg, janvier 2022Authorship Equity and Gender Representation in Global Oncology Publications.
Hornstein et al/
JCO Global Oncol, janvier 2022Gender Disparity in Citations in High-Impact Journal Articles.
Chatterjee P, et al.
JAMA Netw Open. 2021 Jul 1;4(7):e2114509.Representation of Women Among Editors in Chief of Leading Medical Journals.
Pinho-Gomes AC, et al.
JAMA Netw Open. 2021 Sep 1;4(9):e2123026.European Journal of Emergency Medicine position on reporting sex and gender.
Bloom B.
Eur J Emerg Med. 2021 Oct 1;28(5):330.Women's representation in French Internal Medicine meetings: gender distribution among speakers, moderators and organisers, 2013-2018
Roeser A, et al. Intern Med J. 2020 Apr;50(4):477-480.Women underrepresented on editorial boards of 60 major medical journals. Amrein K, et al. Gend Med. 2011 Dec;8(6):378-387.
Differences in clinical practice guideline committee membership by sex [Abstract presented at ATS 2017]. Merman E et al. Am J Resp Crit Care Med. 2017;195.
Inégalités en médecine et plafond de verre
Equal pay for equal work in radiology: Expired excuses and solutions for change.
Pandit et al.
Clin imaging, janvier 2022The reduction of race and gender bias in clinical treatment recommendations using clinician peer networks in an experimental setting.
Centola et al.
Nat Commun., novembre 2021Le rapport 2021 de la British Médical Association : « Sexism in Medicine »
State of Women in Medicine: History, Challenges, and the Benefits of a Diverse Workforce.
Joseph MM, et al.
Pediatrics. 2021 Sep;148(Suppl 2):e2021051440C.Gender inequality among medical, pharmaceutical and dental practitioners in French hospitals: Where have we been and where are we now?
Le Boedec A, et al.
PLoS One. 2021 Jul 9;16(7):e0254311.- Plafond de verre et carrière de femmes médecins.
Le Jeunne C.
Presse Med Form 2021; 2: 207-209 - “Manels” and what to do about them. Mary E Black BMJ Opinion December 7, 2018. Available at: https://blogs.bmj.com/bmj/2018/12/07/mary-e-black-manels-and-what-to-do-about-them/ Accessed December 5 2019
- Sex differences in physician salary in US public medical schools. Jena AB, et al. JAMA Intern Med. 2016 Sep 1;176(9):1294-1304
- Working toward gender diversity and inclusion in medicine: myths and solutions. Kang SK, et al Lancet. 2019 Feb 9;393(10171):579-586.
Association of Physician Characteristics With Perceptions and Experiences of Gender Equity in an Academic Internal Medicine Department. Ruzycki SM et al. JAMA Netw Open.2019 Nov 1;2(11):e1915165.
A neuroscientific approach to increase gender equality. Schreiweis C et al. Nat Hum Behav 3, 1238–1239 (2019)
Physician Work Hours and the Gender Pay Gap - Evidence from Primary Care. Ganguli I et al. N Engl J Med. 2020 Oct 1;383(14):1349-1357.
When a Specialty Becomes "Women's Work": Trends in and Implications of Specialty Gender Segregation in Medicine. Pelley E, et al. Acad Med. 2020 Oct; 95(10):1499-1506.
-
Sex disparities in ICU care and outcomes after cardiac arrest: a Swiss nationwide analysis
Simon A. et al. Critical Care, Jan. 2025
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-025-05262-5 -
Sex specific differences in short-term mortality after ICU-delirium | Critical Care
Schreiber et al. Critical Care, Dec. 2024
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-024-05204-7 -
Assessment of Racial, Ethnic, and Sex-Based Disparities in Time-to-Antibiotics and Sepsis Outcomes in a Large Multihospital Cohort
Mak T et al. Critical Care Medicine, Dec. 2024
https://journals.lww.com/ccmjournal/fulltext/2024/12000/assessment_of_racial,_ethnic,_and_sex_based.13.aspx -
Sex disparities in myocardial infarction related cardiogenic shock - PubMed
Elma J Peters et al. Int J Cardiol, Feb. 2025
https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(24)01352-4/fulltext -
Gender/Sex Disparities in the COVID-19 Cascade From Testing to Mortality: An Intersectional Analysis of Swiss Surveillance Data - PMC
Auderset, Diane et al. International journal of public health, May. 2024
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11148283/ -
Sex Differences in Sepsis-Related Acute Respiratory Distress Syndrome and Other Short-Term Outcomes among Critically Ill Patients with Sepsis: A Retrospective Study in China.
Zhao Hui et al. Shock, Feb. 2025
https://journals.lww.com/shockjournal/abstract/9900/sex_differences_in_sepsis_related_acute.591.aspx -
Retrospective analysis of a tertiary care centre of sex differences in risk factors, aetiology and short-term clinical outcome after revascularization treatment in young adults’ ischemic stroke | Neurological Sciences
Renna et al. Neurol Sci., Mar 2025
https://link.springer.com/article/10.1007/s10072-024-07859-0 -
Sex disparities in acute-on-chronic liver failure: From admission to the intensive care unit to liver transplantation - ScienceDirect
Cerutti et al. Digestive and liver disease, Feb 2025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1590865824009216?via%3Dihub -
Sex differences in the SOFA score of ICU patients with sepsis or septic shock: a nationwide analysis - PMC
Zimmermann, Tobias et al. Critical care Jun. 2024
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11210104/ -
Sex Differences in Characteristics, Resource Utilization, and Outcomes of Cardiogenic Shock: Data From the Critical Care Cardiology Trials Network (CCCTN) Registry | Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes
Daniels, Lori B et al. Circulation. Cardiovascular quality and outcomes, Jun 2024
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.123.010614?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed -
Sex Modifies the Severity and Outcome of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage - Rivier - 2025 - Annals of Neurology - Wiley Online Library
Rivier, Cyprien A et al. Annals of neurology 2025
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.27123 -
Sex and gender differences during the lung lifespan: unveiling a pivotal impact | European Respiratory Society
Tondo P et al. European Respiratory Review, Oct 2024
https://publications.ersnet.org/content/errev/34/175/240121 -
Sex disparities in cardiogenic shock: Insights from the FRENSHOCK registry
Manzo-Silberman et al., Journal of Critical Care, août 2024
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883944124002727?via%3Dihub -
Measuring the impact of maternal critical care admission on short- and longer-term maternal and birth outcomes
Masterson et al., Intensive Care Medicine, 7 juin 2024
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38844640/ -
Sexual Minority Status Disparities in Life's Essential 8 and Life's Simple 7 Cardiovascular Health Scores: A French Nationwide Population‐Based Study.
Deraz et al., JAHA, mai 2023
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.122.028429 -
Sex Differences in Intensity of Care and Outcomes After Acute Ischemic Stroke Across the Age Continuum.
Yu et al., Neurology, Janvier 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36180239/#full-view-affiliation-1 -
Temporal trends in mortality and provision of intensive care in younger women and men with acute myocardial infarction or stroke.
Arslani et al. Crit Care, janvier 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36635740/ -
Sex-differences in the longitudinal recovery of neuromuscular function in COVID-19 associated acute respiratory distress syndrome survivors.
Lulic-Kuryllo et al., Front Med, juin 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37435534/ -
Gender Disparities in Presentation, Management, and Outcomes of Acute Pulmonary Embolism.
Alsaloum et al., Am J Cardiol, juillet 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37421732/ -
Sex differences in long-term survival after intensive care unit treatment for sepsis: A cohort study
Thompson et al., Plos One, feb 2023
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281939 -
The influence of patient gender on medical students' care: Evaluation during an objective structured clinical examination,
Le Boudec et al., Patient Educ Couns feb 2023
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36805929/ -
Sex Differences in Mortality of ICU Patients According to Diagnosis-related Sex Balance,
Modra et al., AJRCCM dec. 2022
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.202203-0539OC -
The ratio of adaptive to innate immune cells differs between genders and associates with improved prognosis and response to immunotherapy,
Ahrenfeldt et al., Plos One feb 2023,
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281375 -
Temporal trends in mortality and provision of intensive care in younger women and men with acute myocardial infarction or stroke
Arslani et al., Crit Care jan 2023
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-022-04299-0 -
Association of Surgeon-Patient Sex Concordance With Postoperative Outcomes
Wallis et al.
JAMA, décembre 2021 -
Ainsi que l’article de presse s’en étant fait l’écho
Lire l'article -
Role of sex hormones in cardiovascular diseases.
Lim GB.
Nat Rev Cardiol. 2021. PMID: 3382825 - Présentation du programme « Sexe et Genre en Médecine d’Urgences » dirigée par le Dr. Alyson McGregor, incluant un lien vers un TED Talk de 15 minute
https://www.lifespan.org/centers-services/sex-and-gender-emergency-medicine-sgem - Librairie en ligne fondée par le Laura W. Bush Institute for Women’s Health, le Texas Tech University Health Sciences Center et le Sex and Gender Specific Health Task Force and Program Team; ensemble de présentations sur des problèmes médicaux spécifiques traités sous le prisme de la difference femmes/hommes en santé et dans la recherche médicale
https://www.sexandgenderhealth.org/slide-library.html - Clinical Advances in Sex- and Gender-Informed Medicine to Improve the Health of All: A Review.
Bartz D, et al.
JAMA Intern Med. 2020 Apr 1; 180(4):574-583.
- https://www.huffingtonpost.fr/entry/reconnaissons-les-travaux-sur-les-questions-de-genre-comme-une-expertise-a-part-entiere_fr_6086d377e4b0ee126f6a22e5
- https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/05/08/s-exprimer-en-public-un-defi-encore-plus-difficile-pour-les-femmes_6079610_4401467.html
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/26/sexisme-dans-le-milieu-medical-les-discriminations-et-vexations-doivent-cesser-aussi-bien-pour-les-femmes-medecins-que-pour-l-avenir-de-l-hopital_6053685_3232.html
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/05/un-langage-qui-utilise-le-masculin-comme-valeur-par-defaut-est-exclusif_6093464_3232.html
En dehors de la médecine
Une action pour répertorier les femmes expertes françaises et francophones, pour ne plus s’entendre dire qu’il n’y a pas de femmes expertes.
-
Les femmes sauveront-elles le monde ? | Les Echos
Les Echos, Marie Eloy, présidente de Bouge ta boite et de Femmes de territoire
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-femmes-sauveront-elles-le-monde-2155469#:~:text=Ce%20sont%20massivement%20les%20femmes,Donc%20elles%20agissent -
Les inégalités entre les femmes et les hommes, de l’école au marché du travail | Cour des comptes
Cours des comptes, Andrey Popov - Adobestock
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes-de-lecole-au-marche-du-travail -
Des femmes plus « féministes » et des hommes plus « masculinistes » : le HCE relève une « polarisation » croissante, notamment chez les jeunes
Le Monde, Jan. 2025
https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/01/20/sexisme-le-haut-conseil-a-l-egalite-releve-une-polarisation-croissante-notamment-chez-les-jeunes_6506667_3224.html -
Pourquoi il est grand temps de changer nos représentations des femmes scientifiques.
The Conversation, 11 février 2024
https://theconversation.com/pourquoi-il-est-grand-temps-de-changer-nos-representations-des-femmes-scientifiques-221645 -
« Je me souviens d’avoir eu honte d’être là, les jambes écartées »
Les Jours, 14 février 2024
https://lesjours.fr/obsessions/viol-gynecologie/ep1-traumatisme-ciivise/ -
Le parcours du combattant des patientes abusées par un médecin pour faire condamner leur agresseur
Mediapart, 18 février 2024
https://www.mediapart.fr/journal/france/180324/le-parcours-du-combattant-des-patientes-abusees-par-un-medecin-pour-faire-condamner-leur-agresseur -
Des médecins condamnés pour viols continuent d’exercer
Mediapart, 18 mars 2024
https://www.mediapart.fr/journal/france/180324/des-medecins-condamnes-pour-viols-continuent-d-exercer -
Viols : une 129e femme porte plainte contre le gynécologue du Val-d’Oise
Les Jours, 27 mars 2024
https://lesjours.fr/obsessions/gynecologue-viols/ep13-129-plaintes/ -
Parcoursup 2024 : « Tout au long de leur scolarité, les stéréotypes de genre impactent la façon dont les filles et les garçons se construisent »
Le Monde, 4 avril 2024
https://www.lemonde.fr/campus/article/2024/04/04/parcoursup-2024-tout-au-long-de-leur-scolarite-les-stereotypes-de-genre-impactent-la-facon-dont-les-filles-et-les-garcons-se-construisent_6225917_4401467.html -
Les femmes, premières victimes du burn-out : « Du jour au lendemain, je n’ai plus réussi à lire ni à tenir une conversation avec mes enfants »
Le Monde, 4 avril 2024
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2024/04/04/premieres-victimes-du-burn-out-les-femmes-s-entraident-du-jour-au-lendemain-je-n-ai-plus-reussi-a-lire-ni-a-tenir-une-conversation-avec-mes-enfants_6225869_4497916.html -
Droits des femmes : deux centenaires racontent leur premier vote
France Info, 18 avril 2024
https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/droits-des-femmes-deux-centenaires-racontent-leur-premier-vote_6494633.html -
« La Reprise. Le tabou de la condition des femmes après un congé maternité » : le délicat retour au travail après une grossesse.
Le Monde, 22 septembre 2023
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/08/31/la-reprise-le-tabou-de-la-condition-des-femmes-apres-un-conge-maternite-le-delicat-retour-au-travail-apres-une-grossesse_6187163_1698637.html -
86% des françaises estiment que leur vie est difficile au quotidien en tant que femme.
France Info le 14/12/2023.
https://www.francetvinfo.fr/societe/selon-un-barometre-86-des-francaises-estiment-que-leur-vie-est-difficile-au-quotidien-en-tant-que-femme_6241251.html -
Le Femme Invisible dans le numérique : le cercle vicieux du sexisme.
Rapport du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 07/11/2023.
https://www.vie-publique.fr/rapport/291678-la-femme-invisible-dans-le-numerique-le-cercle-vicieux-du-sexisme -
Les femmes arrêtent massivement leur travail salarié pour s’occuper des enfants.
Le Monde le 06/11/2023.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/11/06/aujourd-hui-encore-les-femmes-arretent-massivement-leur-travail-salarie-pour-s-occuper-des-enfants_6198463_3234.html -
« On a toutes subi le sexisme à l’hôpital et à la fac »
Ouest France le 31/10/2023.
https://www.ouest-france.fr/societe/sexisme/entretien-karine-lacombe-infectiologue-on-a-toutes-subi-le-sexisme-a-lhopital-et-a-la-fac-dfa70578-6e92-11ee-b447-dc953a0c130a -
Violences conjugales : le dépôt de plainte rendu possible aux urgences de tous les hôpitaux franciliens de l’AP-HP
Le Monde le 05/10/2023.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/10/05/violences-conjugales-le-depot-de-plainte-rendu-possible-aux-urgences-de-tous-les-hopitaux-franciliens-de-l-ap-hp_6192669_3224.html -
Les femmes discriminées par la médecine.
Une enquête présentée par Margaïd Quioc pour Médiavivant
https://mediavivant.fr/enquete/les-femmes-discriminees-par-la-medecine/ -
« Le viol, passage presqu’inévitable de la migration ».
Le Monde, 18/09/2023
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/09/18/le-viol-passage-presque-inevitable-de-la-migration-a-marseille-huit-femmes-racontent_6189846_3224.html -
Violences sexuelles dans l’enseignement supérieur : «Seules 12 % des victimes de viols vont parler à leur établissement».
Libération, 11 avril 2023
https://www.liberation.fr/societe/education/violences-sexuelles-dans-lenseignement-superieur-seules-12-des-victimes-de-viols-vont-parler-a-leur-etablissement-20230411_7LSWQSCWNBDP5BVLCBGUVRF634/ -
L’hôpital, mauvais élève de la lutte contre le sexisme.
France Inter, 12 mai 2023
https://www.radiofrance.fr/franceinter/l-hopital-mauvais-eleve-de-la-lutte-contre-le-sexisme-3925707 -
Enquêter sur la santé des femmes au travail : une urgence sanitaire et sociale.
Basta !, 13 juin 2023
https://basta.media/enqueter-sur-la-sante-des-femmes-au-travail-une-urgence-sanitaire-et-sociale-sante-travail-agriculture-pesticides -
La lieutenante-colonelle Aurore, ancienne pilote de Mirage, en guerre contre l'autocensure des jeunes femmes.
France Culture, 23 juin 2023
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/comme-personne/la-lieutenante-colonelle-aurore-ancienne-pilote-de-mirage-en-guerre-contre-l-autocensure-des-jeunes-femmes-6164303 -
Au travail, des « risques invisibles » pèsent sur la santé des femmes.
Le Monde, 30 juin 2023
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/06/30/au-travail-des-risques-invisibles-pesent-sur-la-sante-des-femmes_6179903_1698637.html#xtor=AL-32280270-%5Bwhatsapp%5D-%5Bios%5D. - Sites expertes.fr : C’est le premier annuaire gratuit, 100 % numérique, de toutes les femmes expertes françaises et francophones. Alors que seulement 19 % des expert.e.s invité.e.s dans les médias sont des femmes, le projet des Expertes propose une base de données unique de femmes chercheuses, cheffes d’entreprises, présidentes d’associations ou responsables d’institutions. https://expertes.fr/le-projet/
- Chez les jeunes chercheuses, l’expérience complexe de la grossesse : « Je me sentais coupable d’être enceinte »
- Le Monde, 13 décembre 2022
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/12/13/chez-les-jeunes-chercheuses-l-experience-complexe-de-la-grossesse-je-me-sentais-coupable-d-etre-enceinte_6154136_4401467.html#xtor=AL-32280270-%5Bwhatsapp%5D-%5Bios%5D - Les dépenses d’enseignement supérieur consacrées aux étudiantes inférieures de 18 % à celles allouées aux étudiants.
Le Monde, 31 octobre 2022
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/31/les-depenses-d-enseignement-superieur-consacrees-aux-etudiantes-inferieures-de-18-a-celles-allouees-aux-etudiants_6148046_3224.html#xtor=AL-32280270-%5Bwhatsapp%5D-%5Bios%5D - Rapport 2023 du Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hce/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses - Congé Menstruel : après l’Espagne, la France pourrait l’adopter ?
Public Sénat le 20 février 2023
https://www.publicsenat.fr/article/societe/conge-menstruel-apres-l-espagne-la-france-pourrait-l-adopter-236875 - Congé menstruel : vraie ou fausse bonne idée ?
TV5 Monde le 21 juin 2021
https://information.tv5monde.com/terriennes/conge-menstruel-bonne-ou-mauvaise-idee-413745
Mission Parité dans les médias
Analyser la place des femmes journalistes et des femmes expertes dans l'ensemble des médias pendant la période de confinement et de crise sanitaire, et formuler des propositions pour s'assurer de leur représentativité : c'est l'objectif de la mission sur "la place des femmes en temps de crise" confiée par le Premier ministre à Céline Calvez en avril 2020.
Et dans le presse grand public…
- « Défendons les sciences face aux nouveaux obscurantismes »
Le Monde, Mar 2025
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2025/03/04/defendons-les-sciences-face-aux-nouveaux-obscurantismes_6576330_1650684.html - https://www.europe1.fr/international/parite-vers-un-quota-de-femmes-dirigeantes-dans-les-grandes-entreprises-allemandes-4017575
- https://www.ouest-france.fr/societe/egalite-hommes-femmes/point-de-vue-parite-une-mixite-a-sens-unique-7108011
- https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/11/19/en-litterature-il-etait-une-fois-la-parite_6060310_3260.html
- https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/13/lila-bouadma-reanimatrice-a-l-hopital-bichat-depuis-l-enfance-je-sais-ou-je-vais_6063198_3244.html
- https://www.huffingtonpost.fr/entry/prix-nobel-chimie-emmanuelle-charpentier-les-difficultes-pour-les-femmes-scientifiques-a-faire-carriere_fr_5f7daf62c5b61229a05a1b3c
En dehors de la Médecine…. La parité et le sexisme d’un point de vue sociétal
Ici sont regroupés des articles relatant le caractère systémique du sexisme et de la non-parité, retrouvés dans tous les milieux de travail et dans la société d’une manière générale.
- En mathématiques, les résultats des filles plombés par les stéréotypes de genre
Le Monde, Dec. 2024 - L’être humaine. Fin du masculin générique, début de l’humanité incarnée
Camille Froidevaux-Metterie - Le Monde, 28 octobre 2021 - Les féministes d’aujourd’hui m’émerveillent
Entretien avec l’historienne Michelle Perrot. - Décembre 2021 - Pourquoi les inégalités de genre dans les médias restent tenaces
The Conversation, 22 novembre 2021 - L’écart de scolarisation entre filles et garçons s’est considérablement réduit dans le monde
L’Observatoire des inégalités, le 27 décembre 2021 - Il faut lutter contre les inégalités d’accès aux sciences pour produire des connaissances plus vraies, plus justes
Clémence Perronnet, Le Monde, septembre 2021 - Dans les grandes écoles, des ateliers pour aider les femmes à mieux négocier leur salaire
Le Monde, 28 octobre 2021 - It’s important we recognise the links between climate change biodiversity loss and gender : comment le retentissement de la crise climatique se fait-il plus sentir sur les femmes, et pourquoi les femmes doivent-elles être partie prenante dans les actions pour le climat
Women’s forum - Chiffres-clés 2021 : vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Les dernières statistiques, publiées en ce début d’année, par le ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes - Au travail, la parité ne suffit pas à régler les inégalités. Podcast « Mansplaining »
Slate Audio, par Thomas Messias, le 5 janvier 2022 - Les chantiers sont le terrain de chasse idéal : des étudiantes et chercheuses en archéologie dénoncent le sexisme qui y règne
Alice Raybaud, Le Monde, 09 juin 2020 - Le sexisme reste omniprésent dans la politique française
Solène Cordier, Le Monde, 02 mars 2020 - Du patriarcat au fratriarcat. La parité comme nouvel horizon du féminisme.
Françoise Gaspard, Cahiers du Genre 2011/3 (HS n° 2), pages 135 à 155
Leadership
Ces articles nous éclairent sur les femmes et le leadership ou comment l’organisation structurelle sociétale empêche les femmes d’accéder aux postes décisionnels et entretient l’écart hommes-femmes sur le sujet.
- Merida L Johns. Breaking the Glass Ceiling: Structural, Cultural, and Organizational Barriers Preventing Women from Achieving Senior and Executive Positions. Perspect Health Inf Manag . 2013; 10(Winter):1e. Epub 2013 Jan 1.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3544145/ - Cynthia S Kubu. Who Does She Think She Is? Women, Leadership and the ‘B'(ias) Word. Clin Neuropsychol. 2018 Feb; 32(2):235-251.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29265960/
Confiance en soi
Ici un article qui éclaire le débat sur le manque de « confiance en soi » perçu comme caractéristique féminine mais qui serait avant tout stéréotype construit socialement.
- Marie Donzel, « Les femmes ont-elle moins « confiance en soi » que les hommes ? », Webmagazine EVE, 19 février 2020.
https://www.eveprogramme.com/45062/en-debat-les-femmes-ont-elles-moins-confiance-en-soi-que-les-hommes/
La parité en médecine
-
« Le monde de la santé continue de porter les stigmates d’une médecine pensée par et pour les hommes »
Le Monde, Jan. 2025 - Béguin F. A l’hôpital, les carrières des femmes restent des parcours semés d’obstacles. Le Monde. 07.03.2019.
Retrieved from https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/07/a-l-hopital-les-carrieres-des-femmes-restent-des-parcours-semes-d-obstacles_5432707_3224.html - Accès des femmes aux postes hospitalo-universitaires : il est temps de passer à l’action. Le Monde. 28.12.2018.
Retrieved from https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/28/acces-des-femmes-aux-postes-hospitalo-universitaires-il-est-temps-de-passer-a-l-action_5402887_3232.html - Magal M. Hôpitaux publics : des salaires en hausse, mais des inégalités hommes-femmes. Le Point. 23.03.2017.
Retrieved from https://www.lepoint.fr/societe/hopitaux-publics-des-salaires-en-hausse-mais-des-inegalites-hommes-femmes-23-03-2017-2114233_23.php
-
« Nous, médecins, souhaitons dénoncer publiquement le sexisme systémique dans le monde médical hospitalier et universitaire »
Le Monde, Fév 2025
https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/02/17/nous-medecins-souhaitons-denoncer-publiquement-le-sexisme-systemique-dans-le-monde-medical-hospitalier-et-universitaire_6550352_3232.html -
Un podcast important sur le #MeeToo de l'hôpital : le Serment d'Augusta | France Inter
France Inter, Erwann Gauche, Dec 2024
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-podcasts-du-week-end/les-podcasts-du-week-end-du-samedi-14-decembre-2024-9270829 -
Des viols commis lors des "soirées d'intégration", un rapport accablant sur la faculté de médecine de Tours rendu public
France info, Patrick Ferret, Mar 2025
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/des-actes-que-la-justice-pourrait-qualifier-de-viol-apres-le-scandale-de-la-banderole-ghbites-un-rapport-accablant-sur-la-faculte-de-medecine-3127717.html -
Perceived sexual harassment and gender differences in anesthesiology: a cross-sectional survey - PMC
Shenoy, Renuka et al. Frontiers in public health Feb. 2025
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11864136/ -
#MeToo à l’hôpital : « Les jeunes femmes qui témoignent ne sont pas seules »
Le Parisien, 11 avril 2024
https://www.leparisien.fr/societe/sante/metoo-a-lhopital-les-jeunes-femmes-qui-temoignent-ne-sont-pas-seules-11-04-2024-T4QW7SH65VGKBGQCTLAYIDOE6Y.php -
"Il m'a plaquée contre le mur et m'a touché les seins" : d'anciennes internes en médecine racontent les agressions subies à l'hôpital et le silence de l'institution
France Info, 15 avril 2024
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/le-choix-de-franceinfo/il-m-a-plaquee-contre-le-mur-et-m-a-touche-les-seins-d-anciennes-internes-en-medecine-racontent-les-agressions-subies-a-l-hopital-et-le-silence-de-l-institution-7108140 -
« Les chirurgiens voyaient les externes comme de la chair fraîche » : le bloc, haut lieu de prédation sexuelle
Le Parisien, 4 mai 2024
https://www.leparisien.fr/societe/les-chirurgiens-voyaient-les-externes-comme-de-la-chair-fraiche-le-bloc-haut-lieu-de-predation-sexuelle-04-05-2024-LSX2C4DTIRCSHBTM7GLVA52C44.php -
#MeToo hôpital : l’Ordre des médecins admet avoir trop peu agi face aux violences sexistes et sexuelles
Causette, 28 mai 2024
https://www.causette.fr/societe/en-france/metoo-hopital-lordre-des-medecins-prend-ses-responsabilites-face-aux-violences-sexistes-et-sexuelles/ -
L'hôpital fait enfin son Metoo
France Inter, 31 mai 2024
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/anne-cecile-mailfert-en-toute-subjectivite/anne-cecile-mailfert-en-toute-subjectivite-du-vendredi-31-mai-2024-9160562
Silence sous la blouse, de Cécile Andrzejewski, éditions Fayard
Culture du secret, fonctionnement en vase clos, organisation confuse, justice de pairs, culte du chef, cette enquête sur les violences sexuelles à l'hôpital plonge les novices dans le système peu connu mais ravageur de l’hôpital public. Bien loin du simple fait divers, ces affaires constituent le fruit pourri d’un appareil qui permet et perpétue l’impunité des blouses blanches.
Pilules roses – De l’ignorance en médecine, de Juliette Ferry-Danini, Stock essais, octobre 2023
Le Spasfon est l’un des médicaments les plus prescrits et vendus en France, en majorité aux femmes, notamment pour le traitement des règles douloureuses. Pourtant, aucun essai clinique ne soutient son efficacité pour cette indication.
Juliette Ferry-Danini retourne aux origines de ce médicament et décortique son développement lié intimement à la mauvaise prise en charge de la santé des femmes. Dans cet essai de philosophie féministe, l’autrice analyse les conséquences de cette ignorance en médecine et propose des outils essentiels pour redonner du pouvoir et de l’autonomie aux patientes et patients.
Les patientes d’Hippocrate, de Maude Le Rest, Eva Tapiero, éditions Philippe Rey.
Pourquoi les douleurs des femmes peinent-elles à être entendues et prises en compte par le corps médical ? Pourquoi les infarctus du myocarde sont-ils plus tardivement détectés chez les femmes que chez les hommes ? Pourquoi, lorsqu’un couple souffre d’infertilité, est-ce presque toujours prioritairement la femme qui est considérée comme responsable et soumise à des batteries de tests ?
Les journalistes Maud Le Rest et Eva Tapiero ont recueilli les paroles de femmes confrontées à une médecine qui traite encore les femmes et leurs symptômes de manière différente. Ces témoignages ont été confrontés à des études, et montrent l’importance persistante des biais de genre et des violences sexistes dans le soin.
Le Temps des Féminismes, de Michelle Perrot, éditions Grasset.
Première historienne à enseigner l’histoire des femmes en France, en 1973, Michelle Perrot nous emmène dans une épopée au féminin en explorant toutes ses ramifications : l’histoire de l’accession à l’égalité, l’histoire du patriarcat, l’histoire du mouvement féministe et des grands débats qui l’ont parcouru et structuré, sur le corps, le genre, l’universalisme contre le différentialisme, la sororité, MeToo.
L’École des Soignantes, de Martin Winckler, éditions P.O.L, 2019
2039, Centre Hospitalier de Tourmens. Là, on ne soigne pas comme ailleurs : dès 2022, un mouvement féministe transforme le CHU en école expérimentale et révolutionne l’apprentissage du soin, concentre ses efforts sur l’accueil bienveillant, la formation de professionnelles de santé empathiques et une approche globale des personnes. La médecine qu’on pratique est centrée avant tout sur la santé des femmes. Hannah y entame sa formation à l’École des Soignantes.
Une réflexion sur le futur du soin, et ce que peut lui apporter une révolution féministe, tant pour les soigné·es que pour les soignantes.
Les Couilles sur la Table, de Victoire Tuaillon, éditions Points, 2021
Qu’est-ce que ça veut dire d’être un homme, en France, au XXIe siècle ? Qu’est-ce que ça implique ? Pour dépasser les querelles d’opinion et ne pas laisser la réponse aux masculinistes qui prétendent que “le masculin est en crise”, Victoire Tuaillon s’est emparée frontalement de la question, en s’appuyant sur les travaux les plus récents de chercheuses et de chercheurs en sciences sociales.
L’adaptation en livre de poche du podcast éponyme qui permet de s’interroger sur la masculinité, les hommes, les femmes et les rapports entre eux, toujours en s’appuyant sur les données de la recherche et les travaux des spécialistes. À mettre entre toutes les mains.
Ainsi soit-elle de Benoite Groult
Court essai pourtant si riche ! Dans Ainsi soit-elle, Benoite Groult retrace l’histoire du féminisme, son évolution mais également ses enjeux actuels et des conseils pour améliorer la condition féminine dans sa globalité. C’est également l’occasion pour l’essayiste - issue d’un milieu bourgeois plutôt traditionnel - de revenir sur l’histoire de sa conversion au mouvement féministe dans les années 1975, et sur l’éveil de son émancipation. On appréciera tout particulièrement l’humour et la joie de vivre de cette femme avide de libertés.
La cause des femmes de Gisèle Halimi
Gisèle Halimi est une grande figure du féminisme français, et plus précisément de la défense de leurs droits. Son nom est attaché au Procès de Bobigny de 1972, premier procès politique de l'avortement dans lequel elle milite pour sa légalisation.
Cet ouvrage retrace le combat de Gisèle Halimi pour soutenir la cause des femmes, le droit à la disposition de leur corps, sa lutte et ses plaidoyers pour légaliser l’avortement et mettre fin à une culture patriarcale inégalitaire et asservissante. Un témoignage passionnant d’une femme qui a marqué son temps, et le nôtre !
Fille de Camille Laurens
Un récit très fort, qui questionne la place des femmes à travers l’expérience d’une femme de sa naissance à l’âge mûr. Une très belle réflexion sur le sens des mots que l’on emploie de façon anodine au quotidien.
Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie
Le roman phare de cette auteure féministe Américano-Nigériane, étoile montante de la littérature. L’histoire d’une jeune femme nigériane qui quitte son pays pour étudier aux Etats-Unis. De multiples questions fondamentales sont abordées : la place des femmes, a fortiori racisées, dans la société, le déracinement, la confrontation à une autre culture…
-
Femme de Santé
LinkedIn -
Les Journées du Matrimoine
https://www.lematrimoine.fr/les-journees-du-matrimoine/ -
Women in Intensive care medicine.
https://www.ficm.ac.uk/careersworkforceworkforce/women-in-intensive-care-medicine -
ANEMF – Guide de lutte contre les VSS
https://anemf.org/guide-de-lutte-contre-les-vss/?utm_source=brevo&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20274&utm_medium=email - Pour s’occuper des questions de genre en soins critiques an Australie et Nouvelle-Zélande, Women in Intensive Care Network (WIN) a vu le jour en 2015.
https://www.womenintensive.org/ - Le Lancet propose des articles scientifiques sur l’équité, la diversité et l’inclusion, actualisés régulièrement.
https://www.thelancet.com/equity-diversity-inclusion
Vous trouverez dans cet onglet des éléments pour vous aider à comprendre les différents statuts hospitaliers, universitaires, et vos droits en termes de maternité. Par ailleurs cet espace détaille aussi la question du harcèlement moral et/ou sexuel au travail (définitions et recours possibles).
Nous avons mis les liens vers les différents textes de référence. La législation étant susceptible d’évoluer, nous ne pouvons garantir l’actualisation en temps réel de ces informations, même si nous nous efforçons de rester à jour.
En cas de question spécifique, nous sommes joignables pour discuter au cas par cas via notre mail femmir@srlf.org
1/ Rappel des différents statuts
1.1/ Hospitaliers :
- Praticien hospitalier (PH) : praticien titulaire. Possibilité de travailler à temps partiel à la demande du praticien si accord du chef de service et de l’administration (dans ce cas l’intitulé est « praticien hospitalier en activité réduite »). Période probatoire d’un an renouvelable.
Existence d’indemnités en cas d’exercice en service public exclusif, et en cas d’activité exercée sur plusieurs établissements
- Praticien des hôpitaux à temps partiel : le praticien est nommé d’emblée sur une quotité de travail réduite (maximum 60%). Le praticien peut avoir en parallèle une activité libérale.
Existence d’indemnités en cas d’exercice en service public exclusif, et en cas d’activité exercée sur plusieurs établissements
- Praticiens contractuels : recrutement pour une durée temporaire (exemple : recrutement sur un poste de titulaire vacant, augmentation transitoire d’activité, remplacement de congé maternité), contrats de 6 mois renouvelables maximum 3 ans. Majoration de 10% par rapport au salaire des titulaires à échelon identique du fait de la précarité du contrat (à partir du 4ème échelon).
Existence d’indemnités en cas d’activité exercée sur plusieurs établissements
- Praticiens attachés : embauchés directement par le centre hospitalier (ne dépendent pas du CNG). Contrats d’un an la première année puis renouvellement tous les 3 ans, indéfiniment reconductible. (NB : praticiens attachés associés : conditions de recrutement allégées, concerne notamment des médecins étrangers avec diplômes valides mais dossier administratif moins complet). Temps de travail défini par le contrat. Possibilité d’exercer sur plusieurs centres hospitaliers. Absence de prime de service public exclusif contrairement aux titulaires.
- Assistants des hôpitaux : premier contrat de un ou 2 ans, renouvelable par périodes d’un an jusqu’à une durée totale maximale de 6 ans.
Existence d’indemnités en cas d’activité exercée sur plusieurs établissements
1.2/ Hospitalo-universitaires :
- Hospitalo-universitaires titulaires :
- Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers (PU-PH)
- Maîtres de Conférence des Universités – Praticiens Hospitaliers (MCU-PH)
- Praticiens Hospitaliers Universitaires (PHU) : exercice des fonctions HU à titre temporaire
- Hospitalo-universitaires non titulaires :
- Chefs de Clinique des universités – Assistants des hôpitaux (CCA)
- Assistants Hospitaliers Universitaires (AHU, pour les disciplines biologiques et pharmaceutiques)
Ces différents statuts sont régis par le décret 84-135 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689714
1.3/ Internes
Le statut des internes est régi par l’article R6153 du code de la santé publique.
2/ Congé maternité, congé parental, congé paternité, mise en disponibilité
2.1/ définitions et généralités :
Congé maternité :
- grossesse simple, premier ou 2ème enfant : 16 semaines (6 semaines en pré natal et 10 semaines en post natal)
- grossesse simple à partir du 3ème enfant : 26 (8 semaines en pré natal et 18 semaines en post natal)
- grossesse gémellaire : 34 semaines (12 semaines en pré natal et 22 semaines en post natal)
- triplés ou plus : 46 semaines (24 semaines en pré natal et 22 semaines en post natal)
Possibilité sur prescription médicale d’avancer de 2 semaines le congé prénatal en cas de grossesse «pathologique», c’est à dire avec des risques ou des complications particulières.
La période pré natale peut être reportée en partie en post natal (maximum 3 semaines), sur certificat médical.
Allaitement : ne prolonge pas le congé post natal, possibilité de conventions collectives définies par l’employeur. Le droit du travail prévoit la possibilité de consacrer du temps à l’allaitement sur les lieux de travail et durant les horaires de travail jusqu’à 1 heure par jour et jusqu’à 1 an après la naissance.
service-public.fr/particuliers/vosdroits ameli.fr/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-adoption
Pour les pères (ou conjoint de la mère) :
-
En cas de naissance d'un enfant, la durée du congé paternité est fixée à 25 jours calendaires: décomposée en 2 périodes: période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance ; et une autre de 21 jours calendaires.
-
En cas de naissances multiples, la durée du congé est fixé à 32 jours calendaires, décomposée en 2 périodes :période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance ;et une autre de 28 jours calendaires.
-
La période de congé de 21 ou 28 jours peut être fractionnée en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.
-
La durée du congé obligatoire de paternité s'ajoute au congé de naissance de 3 jours ouvrables, qui est à prendre de manière continue à partir du jour de la naissance de l'enfant ou du 1er jour ouvrable qui suit.
Congé parental d’éducation :
Ce congé peut être pris par l’un des deux parents, si son ancienneté dans l’entreprise est d’au moins un an. Il doit être pris dans les 3 premières années de l’enfant. Sa durée est d’un an renouvelable 2 fois (dans la limite du 3ème anniversaire de l’enfant). Le contrat de travail et le versement du salaire sont suspendus. Un congé à temps partiel est envisageable, en accord avec l’employeur.
Un parent en congé parental d’éducation peut sous certaines conditions bénéficier de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), versée par la CAF.
2.2/Particularités propres aux médecins hospitaliers
2.2.1/ généralités
Indemnités journalières versées par la sécurité sociale: droit aux versements d’indemnités si l’employée a travaillé au moins 150h au cours des 3 mois précédant la grossesse (équivalent à un tiers temps), ou 600h sur les 12 mois précédant la grossesse. C’est l’employeur (qui a reçu la déclaration de grossesse) qui prévient l’assurance maladie du congé maternité. Le montant des indemnités est calculé à partir du salaire des 3 mois précédant le congé maternité, dans les limites d’un plafond de 3377€ (indemnité journalière maximale 87,71 €, avant déduction de 21% de charges). Le versement se fait en 2 fois par mois tous les 14 jours.
L’employeur prend à sa charge le manque à gagner pour compenser la perte de revenu liée au plafonnement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Concernant les gardes, quel que soit le statut, selon la loi possibilité de s’affranchir des gardes sur décision du médecin du travail, au-delà du 3ème mois de grossesse, et après validation du Directeur Général.
2.2.2/PH titulaires
Seuls les PH titulaires peuvent prétendre à un congé parental. Cela concerne les parents d’enfant de moins de 3 ans, jusqu’à l’âge de 3 ans de l’enfant maximum. Durée d’un an renouvelable.
Seuls les PH titulaires peuvent prétendre à une mise en disponibilité (après validation de la période probatoire). Motifs invocables : convenance personnelle, études et recherche, mutation de conjoint. Durée de 3 ans d’office, renouvelable jusqu’à 10 ans au total sur l’ensemble de la carrière. Nécessite l’accord du chef de service, du chef de pôle et du directeur de la CME. Si la mise en disponibilité est validée par le CNG, la durée initiale étant de 3 ans il est nécessaire de se manifester en cas de désir de reprendre plus tôt. La mise en disponibilité suspend l’avancement dans les échelons d’ancienneté.
2.2.3/Praticiens contractuels
Non éligibles au congé parental
Non éligibles à une disponibilité
2.2.4/Praticien attaché
Si la quotité de travail est inférieure à 3 ½ journées par semaine ou que le praticien est en contrat depuis moins d’un an, pas de prise en charge par l’employeur du manque à gagner après versement des indemnités journalières.
Non éligibles au congé parental
Non éligibles à une disponibilité
2.2.5/assistants des hôpitaux
Non éligibles au congé parental
Non éligibles à une disponibilité
2.3/Particularités propres aux hospitalo-universitaires
Les conditions générales de l’assurance maladie s’appliquent en cas de grossesse. L’employeur principal est l’université, c’est donc avec l’université essentiellement que doit se faire la communication (notamment la déclaration de grossesse)
Mise en disponibilité possible selon les conditions suivantes :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401
2.4/ Particularités propres aux internes
Pour les internes, les conditions générales de l’assurance maladie s’appliquent en cas de grossesse. L’interne a la possibilité de demander un stage en surnombre auprès de l’ARS. Ce stage peut être validant si sa durée prévisible est d’au moins 4 mois (dans ce cas le choix de stage se fait selon le rang de classement de l’interne), ou non validant dans le cas contraire (dans ce cas le choix se fait indépendamment du rang de classement). Au retour du congé maternité l’interne conserve son rang de classement et son ancienneté pour les choix de stage.
Possibilité de mise en disponibilité sur demande auprès de la direction des affaires médicales à faire 2 mois à l’avance.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022392687&categorieLien=id
3/ Harcèlement moral et sexuel au travail
3.1/Définition : Le harcèlement moral ou sexuel est un délit.
Le harcèlement moral consiste en des « agissements malveillants répétés, remarques désobligeantes, intimidations, insultes ». La loi se doit de protéger tout le monde vis-à-vis du harcèlement au travail, qu’il s’agisse de titulaires, contractuels ou stagiaires.
Concernant le harcèlement sexuel, il s’agit de propos ou de comportements à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité par leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante. En cas de contact physique, il peut s’agir d’agression sexuelle.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
3.2/ Recours en cas de harcèlement moral ou sexuel
Attention : En cas d’agression sexuelle ou autre situation d’urgence, appel de la police ou de la gendarmerie.
Possibilité de recourir en parallèle aux différentes mesures ci-dessous
3.2.1/ alerte du CHSCT et des représentants du personnel
3.2.2/ médiation mise en place avec l’employeur, choix du médiateur en accord entre les 2 parties
3.2.3/ saisine du tribunal administratif en l’absence de mesures prises par l’administration (employeur) dans les 2 mois suivant la demande de la victime. Le tribunal administratif est à saisir dans les 4 mois suivant la réception de la demande par l’administration de la victime. Sanction encourue : sanctions disciplinaires.
3.2.4/ saisine de la justice pénale : poursuite de l’auteur du harcèlement, dans les 6 ans à partir du fait le plus récent du harcèlement. Sanction encourue : 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas d’abus de l’autorité conférée par ses fonctions). En cas de plainte classée sans suite, ou en l’absence de suite donnée par le parquet dans les 3 mois suivant la plainte, possibilité de dépôt d’une plainte avec constitution partie civile.
3.2.5/ poursuites civiles : en parallèle de la poursuite pénale. Saisine du tribunal d’instance en cas de litige estimé < 10 000 euros, du tribunal de grande instance en cas de litige estimé > 10 000 euros. Sanction encourue : versement de dommages – intérêts à la victime.
3.2.6/ saisine du défenseur des droits si le harcèlement s’inscrit dans le cadre d’une discrimination sur des critères définis par la loi : discrimination liée au sexe, à la couleur de la peau, à l’âge, à l’orientation sexuelle. Le défenseur des droits peut être saisi à l’égard de l’agresseur ou de l’employeur.
Informations générales : 09 69 39 00 00
Saisine du défenseur des droits par courrier : défenseur des droits, Libre réponse 71120, 75342 Paris CEDEX 07
Saisine du défenseur des droits par messagerie (formulaire sur le site internet : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits ).
- International Women in Intensive and critical care Network (IWIN)
- Women in Intensive Care Medicine Network (WIN)
- Le guide de l’ANEMF sur les Violences Sexuelles et Sexistes
- La collection du Lancet « equity, diversity, inclusion »
- Women in Intensive Care Medicine – Collège Britannique de Réanimation
- Association Donner des Elles à la Santé
- Association Pour Une Meuf
Nous contacter
Si vous avez des questions concernant le groupe et le réseau FEMMIR, mais aussi des suggestions, des idées et des commentaires, vous pouvez nous écrire un mail à l’adresse suivante : femmir@srlf.org. Nous tâcherons de vous répondre dans les plus brefs délais.