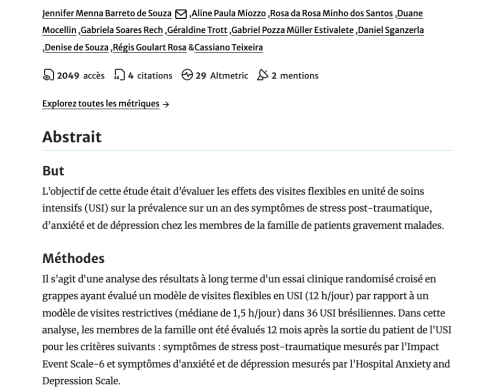
de Souza JMB, Miozzo AP, da Rosa Minho Dos Santos R, Mocellin D, Rech GS, Trott G, Estivalete GPM, Sganzerla D, de Souza D, Rosa RG, Teixeira C. Long-term effects of flexible visitation in the intensive care unit on family members' mental health: 12-month results from a randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2024 Oct;50(10):1614-1621. doi: 10.1007/s00134-024-07577-3. Epub 2024 Aug 22. PMID: 39172240.
Question évaluée :
Les auteurs ont cherché à évaluer l’effet de visites de durée étendue par rapport à des visites dont la durée était restreinte sur la santé mentale des proches visiteurs de patients hospitalisés en réanimation pour des pathologies sévères.
Type d’étude :
L'étude a reposé sur l’analyse des résultats à long terme d'un essai clinique randomisé de type cluster-crossover antérieur et qui avait comparé l’impact de deux modèles de visites sur la survenue d’un état de delirium chez les patients hospitalisés dans 36 services de réanimation brésiliens (1). L’étude commentée s’intéresse, quant à elle, à la prévalence des symptômes de stress post-traumatique (SSPT), d'anxiété et de dépression chez les membres des familles de ces mêmes patients 12 mois après leur sortie de réanimation.
Population étudiée :
Les services participants à l’étude initiale étaient issus d’hôpitaux à but non lucratif, comptaient au moins 6 lits et limitaient habituellement les visites à moins de 4,5 heures par jour (1). Pour chaque patient inclus dans cet essai qui s’est déroulé d'avril 2017 à juin 2018, un membre adulte de sa famille avait été identifié comme étant le plus proche. Le dernier suivi d’un proche a eu lieu en mai 2019.
Méthode :
Les interventions ont consisté en l’application d’une part de visites dites « souples » où 1 à 2 « parents proches » pouvaient être présents jusqu'à 12 heures par jour. Durant cette période, la visite d’autres membres de la famille ou d’amis était aussi possible. Cette modalité était complétée par une formation des personnes identifiées comme « parents proches », animée par les professionnels du service, au cours de laquelle les particularités d’un service de réanimation étaient expliquées (fonctionnement, environnement, procédures, multidisciplinarité, hygiène, lutte contre les infections nosocomiales, gestion du délirium, soins palliatifs). Ceux-ci bénéficiaient en outre d’un soutien social et de la mise à disposition d’un ordinateur ainsi que de l’accès à un site web destinés à les aider à comprendre les processus émotionnels associés au séjour en réanimation. Et d’autre part, les visites dites « restrictives » habituelles ont été poursuivies (durée médiane : 1,5 heure par jour). Dans ce groupe, les proches ne suivaient pas nécessairement le programme de formation d’accompagnement.
Dans les deux groupes, il était demandé aux membres de la famille de quitter l'environnement de soin lors des procédures de réanimation. Par contre, lors de situations particulières, (par ex. fin de vie ou conflit avec l’équipe du service), les proches étaient autorisés à rester plus longtemps lors des visites. Chaque service participant a appliqué alternativement les deux modalités de visites durant la période de l’étude, avec une période de washout de 30 jours entre les deux modalités. Les durées totales des visites pour chaque patient ont été collectés prospectivement dans les deux groupes.
Les proches identifiés préalablement ont été contactés 12 mois après la sortie afin d’obtenir leur consentement à participer à un entretien destiné à évaluer anxiété, SSPT et dépression et réalisé au cours d’un même appel téléphonique mené par un chercheur formé. Les symptômes de SSPT ont été évalués à l’aide de l’échelle Impact of Event Scale (IES-6) (2) et les symptômes d’anxiété et de dépression ont été évalués à l’aide de l’échelle Hospital of Anxiety and Depression Scale (HADS) (3). Les proches qui rencontraient des difficultés de compréhension ou qui n’avaient pas la possibilité d’un contact téléphonique ont été exclus.
Résultats essentiels :
Au total, 1060 proches ayant participé à l’essai initial ont été sélectionnés (532 dans le groupe visites « souples » et 528 dans le groupe visites « restrictives »). A noter que 1685 patients avaient été inclus dans l’étude initiale. Finalement, l’analyse portera respectivement sur 288 et 231 proches, soit 519 membres des familles au total, en raison notamment d’un nombre important de perdus de vue (45.9% vs 56.3%).
Parmi les 541 personnes perdues de vue et exclues de l’analyse à long terme ;
1) il existe une proportion plus importante de personnes sans emploi, retraitées, au niveau d’éducation et aux revenus mensuels plus modestes
2) les antécédents d’anxiété (15.9% vs 8.8%) ou de dépression (14.7% vs 7.8%) sont plus fréquents dans le groupe visites « souples » que dans celui des visites « restrictives » (4).
Parmi les proches qui ont été évalués, la durée de visite quotidienne était significativement plus élevée (p< 0.001) pour les visites « souples » (4.9h) que pour les visites « restrictives » (1.5h). Les visites « souples » ont été associées à une réduction significative de la prévalence des symptômes de SSPT chez les proches (21 % vs 30,5 % dans le groupe visites « restrictives », ratio de prévalence ajusté : 0.91; 95% IC 0.85–0.98; p = 0.01). La prévalence de l'anxiété et les scores moyens d'anxiété ne différaient pas de manière significative entre le groupe des visites « souples » et le groupe des visites « restrictives ». Les membres de la famille du groupe des visites « souples » avaient des scores moyens de dépression significativement plus bas que ceux du groupe des visites « restrictives » (4,48 vs 5,13, p=0,01). Cependant, la prévalence de la dépression possible (HADS > 7) et probable (HADS > 10) ne différait pas significativement entre les deux groupes.
Commentaires :
Les services de soins critiques sont des services anxiogènes pour les familles en raison notamment du risque élevé de décès du patient. C’est dans ce contexte que les démarches centrées sur les proches afin de prévenir leur stress, leur anxiété et le syndrome post-réanimation (PICS-F) (5) deviennent primordiales et font l’objet de recommandations (6). Même si les déterminants des manifestations d’anxiété, de dépression ou de SSPT sont dépendantes de multiples facteurs relatifs au patient, à son parcours et aux proches eux-mêmes, ce travail confirme l’intérêt de mesures spécifiques sur la santé mentale des proches. Ne serait-ce que par l’intermédiaire de l’opportunité accrue d’interactions avec les soignants offerte par l’augmentation du « temps de séjour d’un proche auprès du patient » ! Cette étude contribue également à enrichir la réflexion quant à la nécessité d’un dépistage et d’un suivi des conséquences du séjour en réanimation parmi les proches de nos patients (6,7).
Points forts :
Évaluation d’une stratégie d’accompagnement conséquente envers les proches (Horaires de visite étendus, information et formation spécifiques dédiées, mise à disposition des proches de ressources humaines et techniques).
Points faibles :
Pertes de suivi très significatives dont certaines probablement liées à l’évaluation tardive et ponctuelle à un an de la sortie du patient – Durées de visites non évaluées individuellement (heures/proche) – Pas d’analyse des éléments de la démarche qui auraient pu avoir un bénéfice sur la santé mentale des proches (cf. « Points forts ») – Reproductibilité incertaine dans d’autres pays – Absence d’éléments relatifs à une éventuelle prise en charge des proches en difficultés – Absence d’évaluation de la satisfaction des proches.
Implications et conclusions :
L'impact des politiques de visites en réanimation sur la santé mentale des proches des patients est réel. L'étude confirme que les visites de durée étendue peuvent contribuer à la qualité de la prise en charge et améliorer la santé mentale des proches des patients hospitalisés en réanimation. En France, si l’accessibilité 24h/24 des proches au patient est recommandée depuis maintenant de nombreuses années (8), celle-ci doit certainement être complétée de mesures d’accompagnement des familles. Il est également intéressant de noter que les durées moyennes de visites les plus « longues » (4.9h) rapportées dans ce travail n’apparaissent pas excessives, même si des variations existent certainement d’un visiteur à l’autre. En définitive, les proches ne sont pas aussi « envahissants » que d’aucuns pouvaient le craindre il y a quelques années...
Références cités dans les commentaires
- Rosa RG, Falavigna M, Da Silva DB et al (2019). Effect of flexible family visitation on delirium among patients in the intensive care unit: the ICU visits randomized clinical trial. JAMA 322(3):216–228.
- Caiuby AV, Lacerda SS, Quintana MI et al (2012). Adaptação transcultural da versão brasileira da Escala do Impacto do Evento-Revisada (IES-R) [Cross-cultural adaptation of the Brazilian version of the Impact of Events Scale-Revised (IES-R)]. Cad Saude Publica 28(3):597–603.
- Hosey MM, Leoutsakos JMS, Li X et al (2019). Screening for posttraumatic stress disorder in ARDS survivors: validation of the Impact of Event Scale-6 (IES-6). Crit Care 23:276.
- https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-024-07577-3
- Davidson JE, Aslakson RA, Long AC, et al (2017) Guidelines for Family-Centered Care in the Neonatal, Pediatric and Adult ICU. Crit Care Med 45(1): 103-128
- Haute Autorité de Santé (2023). Diagnostic et prise en charge des patients adultes avec un syndrome post-réanimation (PICS) et de leur entourage. https://www.has-sante.fr
- Rigaud JP, Gélinotte S, Beuzelin M, et al, Consultation post-réanimation : un outil désormais indispensable en 2022. Méd Intensive Réa 2022 31(HS1) 79-86
- Fourrier F (2010). Mieux vivre la réanimation. Réanimation 19 : 191-295
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Article commenté par Jean-Philippe Rigaud, Médecine-Intensive Réanimation CH Dieppe et Jean-Pierre Quenot, Médecine-Intensive Réanimation CHU Dijon-Bourgogne.
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Envoyez vos commentaires/réactions à JRigaud@ch-dieppe.fr, jean-pierre.quenot@chu-dijon.fr et à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
C. DUPUIS
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
G. FOSSAT
N. HIMER
T. KAMEL
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
V. ZINZONI