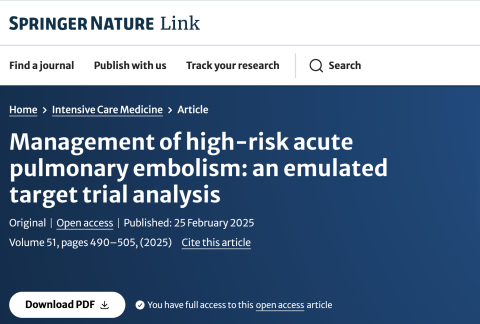
Stadlbauer A, Verbelen T, Binzenhöfer L, Goslar T, Supady A, Spieth PM, Noc M, Verstraete A, Hoffmann S, Schomaker M, Höpler J, Kraft M, Tautz E, Hoyer D, Tongers J, Haertel F, El-Essawi A, Salem M, Rangel RH, Hullermann C, Kriz M, Schrage B, Moisés J, Sabate M, Pappalardo F, Crusius L, Mangner N, Adler C, Tichelbäcker T, Skurk C, Jung C, Kufner S, Graf T, Scherer C, Villegas Sierra L, Billig H, Majunke N, Speidl WS, Zilberszac R, Chiscano-Camón L, Uribarri A, Riera J, Roncon-Albuquerque R Jr, Terauda E, Erglis A, Tavazzi G, Zeymer U, Knorr M, Kilo J, Möbius-Winkler S, Schwinger RHG, Frank D, Borst O, Häberle H, De Roeck F, Vrints C, Schmid C, Nickenig G, Hagl C, Massberg S, Schäfer A, Westermann D, Zimmer S, Combes A, Camboni D, Thiele H, Lüsebrink E; High-risk P. E. Investigator Group. Management of high-risk acute pulmonary embolism: an emulated target trial analysis. Intensive Care Med. 2025 Mar;51(3):490-505. doi: 10.1007/s00134-025-07805-4. Epub 2025 Feb 25. PMID: 39998658; PMCID: PMC12018524.
Question évaluée
Quelle est la meilleure stratégie thérapeutique chez les patients avec une embolie pulmonaire (EP) à haut risque de mortalité : ECMO VA seule ou reperfusion pulmonaire (± ECMO VA) ?
Type d’étude
Emulation d’essai clinique à partir d’une cohorte rétrospective internationale
Population étudiée
Patients majeurs présentant une EP à haut risque de mortalité (selon la définition de l’ESC 2019 1), associée à un choc cardiogénique, une hypotension persistante ou un arrêt cardio-respiratoire.
Les patients ayant bénéficié d’une thrombolyse pré-hospitalière n’étaient pas éligibles.
La période d’inclusion s’étendait de 2012 à 2022.
Méthode
A partir d’une cohorte internationale de patients avec une EP à haut risque, les auteurs ont réalisé une émulation d’essai clinique.
Les patients présentant les critères de sélection ont été assignés à un des quatre groupes de traitement, définis comme suit :
Groupe « ECMO VA seule »
Groupe « thrombolyse intraveineuse »
Groupe « thrombectomie chirurgicale »
Groupe « techniques basées sur le cathétérisme » (thrombectomie percutanée, thrombolyse in situ, thrombolyse avec ultrasons)
Compte tenu du recours fréquent aux traitements multiples (par exemple thrombolyse puis thrombectomie), le patient était assigné au groupe correspondant au premier traitement débuté. Le groupe « ECMO VA seule » faisait exception : si un patient était mis sous ECMO VA puis bénéficiait d’une thrombectomie chirurgicale, il était assigné au groupe « thrombectomie chirurgicale ».
Tous les patients devaient recevoir concomitamment une anticoagulation curative.
En l’absence de randomisation assurant la comparabilité des groupes de traitement, une méthode d’ajustement par modèle de régression logistique sur les principaux facteurs confondant connus (âge, sexe, comorbidités, pH à l’admission, choc ou arrêt cardiaque, durée de réanimation cardiopulmonaire) était appliquée avant l’analyse. Ces facteurs ont été choisis car ils sont connus pour influencer le choix du traitement ou le pronostic.
Le critère de jugement principal était la mortalité hospitalière.
Résultats essentiels
Population :
Parmi les 991 patients inclus dans l’analyse, 126 (13%) ont été assigné au groupe « ECMO VA seule », 643 (65%) « thrombolyse intraveineuse », 49 (5%) « thrombectomie chirurgicale », et 173 (17%) « techniques basées sur le cathétérisme ».
Les caractéristiques initiales des quatre groupes n’étaient pas comparables : les patients du groupe « ECMO VA seule » étaient plus graves, avec un recours plus fréquent à l’implantation d’ECMO sous massage cardiaque.
| ECMO VA seule (n=126) | Thrombolyse intraveineuse (n=643) | Thrombectomie chirurgicale (n=49) | Techniques basées sur le cathétérisme (n=173) |
| Recours à l’ECMO VA | 100% | 30% | 53% | 24% |
| ECMO sous massage cardiaque | 64% | 15% | 25% | 15% |
| Lactates (mmol/L) | 12,9 | 5 | 4,3 | 1,8 |
Critère principal de jugement :
Après ajustement sur les principaux facteurs confondants connus, la probabilité estimée de mortalité hospitalière (intervalle de confiance à 95%) était supérieure dans le groupe « ECMO VA seule », comparativement aux stratégies de reperfusion pulmonaire :
57% (47%; 67%) pour le groupe « ECMO VA seule »
48% (44%; 53%) pour le groupe « thrombolyse intraveineuse »
34% (18%; 50%) pour le groupe « thrombectomie chirurgicale »
43% (35%; 51%) pour le groupe « techniques basées sur le cathétérisme »
Le risk ratio de mortalité hospitalière était systématiquement en faveur de la reperfusion pulmonaire comparativement à l’ECMO VA seule, quelle que soit la technique utilisée.
Critères secondaires de jugement :
Les patients du groupe « ECMO VA seule » ont présenté plus fréquemment un saignement majeur (critères ISTH) et une défaillance multi-viscérale.
| ECMO VA seule (n=126) | Thrombolyse intraveineuse (n=643) | Thrombectomie chirurgicale (n=49) | Techniques basées sur le cathétérisme (n=173) |
| Saignement majeur | 48% | 29% | 33% | 15% |
| Défaillance multi-viscérale | 44% | 28% | 31% | 16% |
| Mortalité hospitalière brute* | 73% | 49% | 31% | 30% |
*Avant ajustement
Commentaires
Contexte : incertitude sur la stratégie idéale chez les patients à haut risque
Les recommandations de l’European Society of Cardiology préconisent la thrombolyse intraveineuse chez les patients avec une EP à haut risque de mortalité et en l’absence de contre-indication (1b) 1. Néanmoins, cette recommandation est principalement basée sur une méta-analyse d’études ayant inclus peu de patients avec EP à haut risque, et dans lesquelles la thrombolyse était comparée à une anticoagulation seule2. Dans ce contexte, une incertitude demeure concernant la stratégie de traitement de ces patients, d’autant plus que les techniques par cathétérisme sont en développement.
En première lecture, cette étude semble enfoncer une porte ouverte : les patients bénéficiant d’ECMO VA seule ont un plus mauvais pronostic que les autres. Cela parait évident car 1) ils sont exposés à la persistance d’un choc obstructif, rendant potentiellement le sevrage de l’ECMO impossible, et surtout, 2) ils sont beaucoup plus graves que les patients ayant bénéficié d’une stratégie de reperfusion pulmonaire : ce n’est pas du tout la même population. Il faut donc se pencher sur la méthodologie de l’émulation d’essai clinique pour comprendre l’apport de cette étude.
Emulation d’essai clinique, qu’est-ce que c’est ?
Cette méthodologie, bien qu’inférieure à celle d’un essai randomisé, permet d’obtenir une estimation de l’effet d’une intervention plus précise qu’une étude observationnelle traditionnelle en minimisant les biais évitables.
L’essai clinique émulé est construit selon un protocole similaire à l’essai contrôlé randomisé :
Etape 1 : définition des critères de sélection
Etape 2 : définition de l’intervention
Etape 3 : définition de la date de début de suivi.
Ces trois éléments doivent idéalement être synchrones. En effet, si le suivi débute plus tard que l’assignation de l’intervention, il existe un biais dit de « déplétion des susceptibles ». C’est-à-dire que les patients bénéficiant de l’intervention et du suivi sont forcément survivants et biaisent l’analyse en faveur du groupe intervention. Si les critères d’éligibilité sont identifiés après le début du traitement, il existe un risque de biais dit de « temps immortel ». C’est-à-dire que les patients décédés sous l’intervention ne seront jamais éligibles, et seuls les survivants seront éligibles.
Etape 4 : définir le critère de jugement
Etape 5 : définir le type d’analyse
Un ajustement sur un maximum de facteurs confondants connus est évidemment nécessaire 3.
Un essai randomisé est toujours préférable à une émulation d’essai clinique. Néanmoins, l’émulation d’essai clinique est utile lorsque la réalisation de l’essai randomisée est impossible (pour des raisons éthiques par exemple), ou en attendant la réalisation d’un essai randomisé pour préciser la taille de l’effet (comme ici), ou encore pour corroborer les résultats d’un essai randomisé existant 4.
Points forts
Il s’agit de la plus large cohorte décrivant le management de patients avec EP à haut risque de mortalité.
Toutes les options thérapeutiques utilisables dans l’EP à haut risque ont été étudiées.
Points faibles
Le principal point faible de cette étude est bien sûr son caractère observationnel, qui empêche malgré la méthode statistique, de conclure formellement sur un lien de causalité entre la stratégie de traitement et le pronostic.
Deuxièmement, bien que les auteurs précisent que dans les centres participants, les patients avaient théoriquement accès à l’ensemble du panel de traitement, on ne peut exclure un biais d’indication, correspondant à l’indisponibilité de certaines techniques pour un patient donné, et donc le choix préférentiel d’une technique par rapport à une autre.
Implications et conclusions
Si la thrombolyse intraveineuse reste à ce jour le traitement de première ligne de l’EP à haut risque, le réanimateur doit avoir en tête les alternatives pour des situations plus complexes (contre-indications, patient stabilisé par ECMO VA préalablement pour arrêt cardiaque par exemple).
Si cette étude ne permet pas de trancher quant à la stratégie idéale de reperfusion en cas d’EP à haut risque, ses résultats n’incitent pas à une stratégie « attentiste » basée sur l’ECMO VA sans reperfusion pulmonaire chez les patients dont le pronostic ne serait pas grevé par l’encéphalopathie anoxique.
En pratique, dans l’attente des résultats d’essais randomisés (PERSEVERE, NCT06588634), la discussion systématique en Pulmonary Embolism Response Team d’une technique de reperfusion pulmonaire quelle qu’en soit la méthode, doit être la règle. L’ECMO VA peut être associée en cas de choc réfractaire ou d’arrêt cardiaque 5.
Dans une perspective de recherche, cette étude incite à ne pas considérer un bras « ECMO VA seule » dans un futur essai randomisé.
Références cités dans les commentaires
- Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J 2020;41(4):543–603.
- Marti C, John G, Konstantinides S, et al. Systemic thrombolytic therapy for acute pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J 2015;36(10):605–14.
- Hernán MA, Robins JM. Using Big Data to Emulate a Target Trial When a Randomized Trial Is Not Available. Am J Epidemiol 2016;183(8):758–64.
- Émulation d’un essai clinique cible à partir de données observationnelles | Webinar [Internet]. 2023. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=Qu4SjHh7XP4
- Chopard R, Nielsen P, Ius F, et al. Optimal reperfusion strategy in acute high-risk pulmonary embolism requiring extracorporeal membrane oxygenation support: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2022;60(5):2102977.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Commenté Pierre-André Pinel et Hadrien Winiszewski, Réanimation médicale, CHU Besançon
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Voir les déclarations de conflits d'intérêt (titre cliquable): Pierre-André Pinel et Hadrien Winiszewski
Envoyez vos commentaires/réactions à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
A.CAILLET
C. DUPUIS
N. FAGE
JP. FRAT
G. FOSSAT
A. GAILLET
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
N. HIMER
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
M. THY