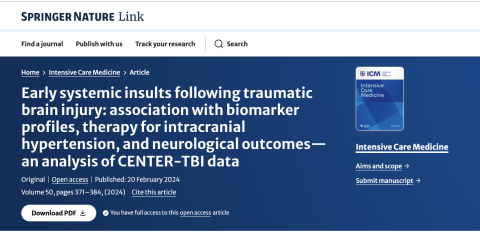
Robba C, Graziano F, Picetti E, Åkerlund C, Addis A, Pastore G, Sivero M, Rebora P, Galimberti S, Stocchetti N, Maas A, Menon DK, Citerio G; CENTER-TBI Participants and Investigators. Early systemic insults following traumatic brain injury: association with biomarker profiles, therapy for intracranial hypertension, and neurological outcomes-an analysis of CENTER-TBI data. Intensive Care Med. 2024 Mar;50(3):371-384. doi: 10.1007/s00134-024-07324-8. Epub 2024 Feb 20. PMID: 38376517; PMCID: PMC10955000.
Rationnel :
L’effet délétère des agressions cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS) sur le pronostic des patients traumatisés crâniens (TC) est documenté depuis les années 1990, motivant le contrôle de ces paramètres après un TC. Ces désordres systémiques sont supposés favoriser des phénomènes inflammatoires centraux et systémiques, l’activation microgliale, la coagulopathie, altérer la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Les causes neurobiologiques de l’association entre les ACSOS et le pronostic n’est pas élucidé. Les auteurs font l’hypothèse d’une association entre certaines agressions systémiques (hypotension et hypoxie) et les lésions cellulaires (neuronales et gliales), quantifiés par dosage de biomarqueurs sanguins.
Question évaluée :
Quel est l’impact des agressions systémiques (hypoxie et hypotension) sur les biomarqueurs de lésions cérébrales, le niveau des assistances, et le pronostic neurologique à 6 mois des patients traumatisés crâniens.
Type d’étude :
Prospective (2014-2017), multicentrique observationnelle (65 centres européens et Israël), étude ancillaire de la cohorte prospective CENTER-TBI (1)
Population étudiée :
Patients >18 ans
Admis en réanimation pour un TC (<24h)
Disponibilité des données de pression artérielle et d’oxygénation sanguine en pré-hospitalier et/ou à l’arrivée
Statut neurologique à 6 mois (GOSE) connu
Méthode :
Critères de jugement : biomarqueurs, niveau des assistances, GOSE à 6 mois (GOSE 1 = décès, GOSE 8= Récupération complète, bon pronostic GOSE >4)
Dosage de biomarqueurs (BM) et ratio de biomarqueurs (rBM) sériques :
-Marqueurs de lésions gliales : GFAP, protéine S100B
-Marqueurs de lésions neuronales (corps cellulaire) : UCH-L1, NSE
-Marqueurs de lésions axonales et dendritiques : NfL, protéine tau.
-Le ratio UCH-L1/ GFAP était proposé pour juger la proportion de lésion neuronale (corps cellulaire) versus gliale,
-Le ratio Tau/GFAP était utilisé pour évaluer la proportion de lésion axonale versus gliale.
Les prélèvements en vue des dosages des BM étaient réalisés dans les 48 heures suivant l’admission.
Statistiques :
-Comparaisons des variables cliniques entre 4 groupes d’ACSOS : 1) absence d’ACSOS identifiées ; 2) hypoxie isolée ; 3) hypotension isolée ; 4) hypoxie et hypotension (Chi2 ou Kruskall-Wallis).
-Identification des facteurs associés avec la survenue des ACSOS par régression logistique.
-Recherche des corrélations entre les 4 groupes d’ACSOS, BM et rBM (index de Pearson).
-Évaluation des facteurs associés au pronostic défavorable et à la mortalité par régression logistique & modèle de Cox.
Résultats essentiels :
Sur les 4509 patients de l’étude CENTER-TBI, 1695 patients étaient inclus dans l’analyse. L’âge médian était de 52 (33-67) ans. Le GCS médian à l’admission était de 9. 1280 (75%) patients n’avaient pas de facteurs d’agression systémique identifiés en préhospitalier ou à l’admission. Une hypoxémie était documentée dans 273 (16,1%) cas et une hypotension dans 257 (15,2%) cas. Les deux étaient présentes chez 115 (6.8%) patients.
Les 4 groupes de patients présentaient des caractéristiques démographiques comparables mais le groupe 4 (hypoxémie + hypotension), présentait des critères clinico-biologiques de sévérité plus importante (CGS, pH, lactatémie, lésions extra-crâniennes).
Biomarqueurs sériques :
-Le taux de BM était plus élevé chez les patients ayant présenté une hypoxémie ou une hypotension, et encore plus élevé lorsque l’’hypotension était associée à l’hypoxémie.
-Des corrélations significatives entre BM étaient observées.
-Les lésions relatives neuronales/gliales, illustrées par les ratios UCH-L1/GFAP et Tau/GFAP, mettaient en évidence des ratios inférieurs pour les patients qui n’avaient présenté aucune agression systémique, significativement plus élevés chez les patients hypotendus (p= 0,013), et les ratios les plus élevés chez ceux ayant présenté hypotension et hypoxémie (p=0,002).
Niveau des assistances :
La mesure de PIC était plus fréquemment observée chez les patients présentant des agressions systémiques. Le recours aux transfusions, à la ventilation mécanique et à la trachéotomie était plus fréquent chez les patients présentant une hypotension.
Pronostic clinique à 6 mois :
380 (22%) des patients étaient décédés à 6 mois et 759 (45%) avaient un score de GOSE ≤4. Les patients ayant présenté au moins une agression systémique avaient une mortalité plus élevée que ceux qui n’avaient ni hypotension ni hypoxie (31,8 vs 19% p<0,001). En analyse multivariée, les patients ayant présenté une hypotension avec ou sans hypoxémie avaient un risque significativement plus élevé de pronostic défavorable (GOSE≤4). Des niveaux croissants de BM (valeurs logarithmiques) étaient significativement associés à un pronostic défavorable. Il n’y avait pas d’interaction entre agression systémique et valeurs de BM sériques.
Commentaires :
-Les résultats de ce travail doivent être interprétés en prenant en compte les différences de sévérité initiale entre les groupes, notamment pour le groupe le plus sévère présentant à la fois hypoxémie et hypotension.
-On note une dispersion importante des données pour les dosages de BM / rBM et beaucoup de chevauchement entre les groupes. Les résultats ne permettent pas de définir des seuils discriminants entre les groupes.
-Les résultats portent sur les ACSOS en pré-hospitalier et à l’admission des patients à l’hôpital et non la gestion stricte des agressions systémiques une fois les patients en soins critiques. Les conclusions portent davantage sur la gravité initiale des patients que sur l’effet potentiel du contrôle des agressions systémiques sur la mortalité ou le pronostic des patients.
-Attention à ne pas conclure à un lien de causalité entre agressions systémiques et BM, car il s’agit d’une association statistique sans preuve de cause à effet.
Points forts :
-Cohorte multicentrique européenne de TC en phase aiguë avec un effectif important, des données préhospitalières et d’admission bien renseignées, et peu de données manquantes sur le pronostic.
-Originalité de ce travail translationnel cherchant à établir une association entre la présence d’un évènement systémique et les lésions neuronales/gliales dans le TC. Le focus porté aux patients les plus graves en soins critiques et le postulat physiopathologique (comprendre les conséquences neuronales/ gliales des ACSOS) est intéressant.
Points faibles :
- Différences intrinsèques de gravité entre les groupes qui obligent à la prudence dans l’interprétation des résultats et ce, malgré les efforts faits pour les prendre en compte dans l’analyse.
-Le choix méthodologique de présenter un ratio de BM parait discutable, l’interprétation de chaque biomarqueur isolément est plus simple et mieux documentée dans la littérature.
-La pression de perfusion cérébrale n’est pas documentée, elle aurait été un bon reflet physiologique de la perfusion cérébrale.
-La cinétique évolutive des BM sériques est un point fondamental à prendre en compte. Les données de la littérature stipulent une cinétique évolutive au cours des premières heures post-admission (eg. GFAP continue à augmenter entre H1 et H20, UCH-L1 atteint son pic à 8h (2)). Dans ce travail, le délai entre le traumatisme primaire et le prélèvement des BM n’est pas renseigné, et les BM n’ont pas été dosés de manière répétée.
-La description des lésions extracrâniennes semble insuffisante. Leur influence sur ces BM est potentiellement majeure.
Implications et conclusions :
A ce jour, la littérature permet de retenir l’utilisation du dosage précoce de GFAP dans les TC mineurs en tant que biomarqueur associé à des lésions scanographiques (aide au tri et épargne d’irradiation) ainsi qu’à des lésions histopathologiques minimes non visibles à l’imagerie (3). Sa place dans les TC sévères admis en réanimation reste difficile à clarifier : potentiel biomarqueur de sévérité, son utilisation n’est pas recommandée en première intention (4).
Ce travail adresse la question des mécanismes des ACSOS, via le dosage de BM sériques. Les auteurs concluent que les patients ayant été exposés aux agressions systémiques précoces (hypoxémie et hypotension) présentent un taux de BM sanguins plus élevés et suggèrent une susceptibilité plus importante des neurones (versus les cellules gliales) à ces agressions. Cette « signature » biologique des ACSOS doit être interprétée avec précaution, notamment du fait des différences de sévérité (du traumatisme crânien et extra crânien) entre les différents groupes étudiés. Ce travail ouvre des hypothèses physiopathologiques sur le lien entre agressions systémiques et lésion cérébrale, sans preuve de causalité. Il ne permet pas d’assoir ou de modifier le positionnement des BM en pratique de routine dans le TC grave.
Références cités dans les commentaires :
Steyerberg EW, Wiegers E, Sewalt C, Buki A, Citerio G, De Keyser V, et al. Case-mix, care pathways, and outcomes in patients with traumatic brain injury in CENTER-TBI: a European prospective, multicentre, longitudinal, cohort study. Lancet Neurol. oct 2019;18(10):923‑34.
Papa L, Brophy GM, Welch RD, Lewis LM, Braga CF, Tan CN, et al. Time Course and Diagnostic Accuracy of Glial and Neuronal Blood Biomarkers GFAP and UCH-L1 in a Large Cohort of Trauma Patients With and Without Mild Traumatic Brain Injury. JAMA Neurology. 1 mai 2016;73(5):551‑60.
Abdelhak A, Foschi M, Abu-Rumeileh S, Yue JK, D’Anna L, Huss A, et al. Blood GFAP as an emerging biomarker in brain and spinal cord disorders. Nat Rev Neurol. mars 2022;18(3):158‑72.
Geeraerts T, Velly L, Abdennour L, Asehnoune K, Audibert G, Bouzat P, et al. Management of severe traumatic brain injury (first 24 hours). Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. avr 2018;37(2):171‑86.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Commenté par : Benjamine SARTON, Réanimation Polyvalente hôpital Purpan, CHU de Toulouse, Toulouse, France, Pour la CRT de la SRLF,
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Envoyez vos commentaires/réactions à Sarton.b@chu-toulouse.fr et à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
A.CAILLET
C. DUPUIS
N. FAGE
JP. FRAT
G. FOSSAT
A. GAILLET
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
N. HIMER
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
M. THY