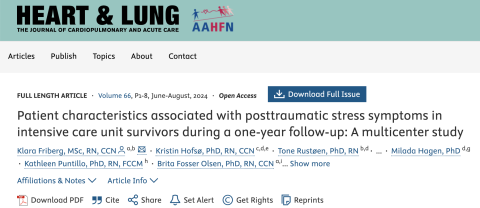
Friberg, K., Hofsø, K., Rustøen, T., Ræder, J., Hagen, M., Puntillo, K., & Olsen, B. F. (2024). Patient characteristics associated with posttraumatic stress symptoms in intensive care unit survivors during a one-year follow-up: A multicenter study. Heart & lung : the journal of critical care, 66, 1–8
Question évaluée :
- Quelle est la prévalence de niveaux élevés des symptômes de stress post-traumatique (SSPT) pendant l’année qui suit la sortie de réanimation, considérant comme niveaux élevé un score seuil ≥ 33 à l'échelle révisée d’impact des évènements (IES-R) ?
- Est-il possible d’identifier des combinaisons de caractéristiques liées au patient, regroupées en classes, associées aux SSPT à 3, 6 et 12 mois ?
Type d’étude :
Étude ancillaire longitudinale de cohorte, à partir d’une étude prospective observationnelle multicentrique conduite dans deux hôpitaux du Sud-est de Norvège, comprenant six unités de réanimation.
Population étudiée :
Patients âgés de plus de 18 ans recevant ventilation mécanique, amines vasopressives ou monitorage continu > 24h, ayant répondu à un questionnaire évaluant le Syndrome Post-Traumatique (SPT) avant l’admission en réanimation, à 3, 6 ou 12 mois de la sortie (Impact of Event Scale-Revised, IES-R).
Méthode :
L'IES-R a été utilisée pour évaluer les SSPT. Les investigateurs ont procédé à une analyse en classe latente à partir de 20 variables issues des données démographiques et cliniques présentes à l’admission (données avant admission en réanimation, données démographiques et caractéristiques cliniques), puis réduites à 12, afin de déterminer si des combinaisons spécifiques étaient associées au SSPT. Les facteurs prédictifs possibles ont été analysés à l'aide de statistiques descriptives, d'une analyse de classes latentes et d'un modèle mixte linéaire pour les mesures répétées. Les patients ont été divisés en deux échantillons : l’échantillon 1, comprenant 174 patients ayant répondu à l'IES-R à 3, 6 et 12 mois, a permis d’estimer la prévalence de niveaux élevés de SSPT aux différents points d'évaluation. L'échantillon 2, comprenant 417 patients ayant répondu à l'IES-R avant leur admission en réanimation, a permis de réaliser l'analyse de classes latentes et ajuster le modèle mixte pour des mesures répétées.
Résultats essentiels :
Sur 1 234 patients éligibles, 603 ont accepté de participer. A partir du premier échantillon (n = 174), les investigateurs ont rapporté des niveaux élevés de PTSS (IES-R ≥ 33) :
- À 3 mois pour 14,9 % des patients (intervalle de confiance [IC] à 95 % [10,0 ; 21,1]);
- À 6 mois, pour 16,7 % (IC à 95 % [11,5 ; 23,1]);
- À 12 mois, pour 18,4 % des patients (95 % % IC [12,9 ; 25,0]).
A partir du deuxième échantillon et des variables sélectionnées, trois classes latentes ont été identifiées :
- La classe 1 (n = 162, 100 %) comprenait les patients en activité professionnelle (n = 87, 53.7 %) de moins de 50 ans (n = 73, 45.1%).
- La classe 2 (n = 62, 100 %) comprenait essentiellement des hommes (n = 41, 66.1 %) avec une durée d’hospitalisation de plus de 11,5 jours (n = 62, 100 %).
- La classe 3 (n = 193, 100 %) était composée essentiellement de patients avec un niveau d’éducation maximum école primaire ou secondaire (n = 133, 68.9 %), avec un âge ≥ 70 ans (n = 101, 52.3 %), et avec un score SAPS II ≥ 40.0 points (n = 173, 89.6 %) et ayant reçu de la ventilation mécanique durant le séjour en réanimation (n = 152, 78.8 %)
Le modèle mixte par mesures répétées a permis de mettre en avant deux sous-groupes qui étaient significativement associées à la survenue de SSPT :
- Les patients de la classe 2 présentaient plus de SSPT à 6 mois.
- Les patients de la classe 3 présentaient plus de SSPT à tous les points de mesure (1 à 3,6 et 12 mois).
Commentaires :
Il est intéressant de noter que cette tendance à une prévalence s’accentuant à distance du séjour est aussi retrouvée dans d’autres études longitudinales, comme dans l’étude de Schmidt et al. (1), où un quart des patients avait des valeurs de SSPT plus élevées même au bout de 2 ans de suivi. En revanche, la prévalence des SSPT (18,4% au plus élevé, à 12 mois) semble inférieure à celle constatée dans la majorité des études récentes ; certes, de nombreuses études sur le SPT sont centrées sur le COVID-19, mais même dans des études plus anciennes, la prévalence des SSPT est globalement supérieure, pouvant aller jusqu’à 36% à un mois (2); cet écart pourrait s’expliquer par le type d’échelle ou le seuil choisis, car il y a un manque d’homogénéité dans les outils utilisés dans les différentes études, ou liée à un biais de sélection comme par exemple la sévérité initiale des patients. Une deuxième différence est que, jusqu’à présent, les groupes à risque identifiés étaient souvent formés par des patients plus jeunes, de sexe féminin, où les mauvais souvenirs et expériences en réanimation étaient un facteur contributif important aux SPT (1, 3, 4). La méthode d’association de classes latentes pourrait révéler des liens différents et non observables dans les analyses conventionnelles, qu’il serait pertinent d’approfondir pour vérifier leur pertinence.
Points forts :
- Le point fort de cette étude est le grand nombre de patients suivis sur une longue période, ce qui a permis d’effectuer des mesures répétées et identifier ainsi des associations entre les SSPT et des profils de patients.
Points faibles :
- L’évaluation IES-R pré-réanimation a été recueillie après l'admission, ce qui pourrait induire un biais de rappel.
- Sur les 1 234 patients éligibles, un peu moins de la moitié (n=603, 49 %) ont accepté de participer, ce qui pourrait avoir entraîné un biais de sélection.
Implications et conclusions :
Les niveaux les plus élevés de SSPT ont été retrouvés à 12 mois du séjour en réanimation, résultat consistant avec toutes les autres études, et qui met en évidence la nécessité d’une observation à long terme, dépassant une année de suivi, même chez les patients présentant peu de symptômes initialement.
Le deuxième intérêt de cette étude est l’identification des profils de patient à risque, ce qui permettrai aux professionnels de santé d’effectuer un dépistage en amont. L’analyse de classes latentes a permis de mettre en évidence, pour la première fois, un groupe particulièrement exposé, les personnes de ≥ 70 ans, avec des scores de gravité élevés. Il est fondamental de creuser cette nouvelle voie pour voir si ces résultats se confirment, et pouvoir, dans ce cas, envisager des interventions appropriées par classe de patient.
Références cités dans les commentaires
- Schmidt, K. F. R., Gensichen, J. S., Schroevers, M., Kaufmann, M., Mueller, F., Schelling, G., Gehrke-Beck, S., Boede, M., Heintze, C., Wensing, M., & Schwarzkopf, D. (2024). Trajectories of post-traumatic stress in sepsis survivors two years after ICU discharge: a secondary analysis of a randomized controlled trial. Critical care (London, England), 28(1), 35. https://doi.org/10.1186/s13054-024-04815-4
- Girard, T. D., Shintani, A. K., Jackson, J. C., Gordon, S. M., Pun, B. T., Henderson, M. S., Dittus, R. S., Bernard, G. R., & Ely, E. W. (2007). Risk factors for post-traumatic stress disorder symptoms following critical illness requiring mechanical ventilation: a prospective cohort study. Critical care (London, England), 11(1), R28. https://doi.org/10.1186/cc5708
- Bi, Y., Xiao, Y., Pan, X., Zhang, Y., Yang, Q., & Hu, L. (2023). Long-term post-traumatic stress symptoms in COVID-19 survivors and its risk factors: a two-year longitudinal cohort study. Psychiatry research, 329, 115523. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115523
- Martins, S., Ferreira, A. R., Fernandes, J., Vieira, T., Fontes, L., Coimbra, I., Paiva, J. A., & Fernandes, L. (2022). Depressive and Anxiety Symptoms in Severe COVID-19 Survivors: A Prospective Cohort Study. The Psychiatric quarterly, 93(3), 891–903. https://doi.org/10.1007/s11126-022-09998-z
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Article commenté par Silvia Calvino Günther, Fonds One-0-One, Paris, France.
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Envoyez vos commentaires/réactions à scalvino@one-o-one.eu et à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
C. DUPUIS
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
G. FOSSAT
N. HIMER
T. KAMEL
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
V. ZINZONI