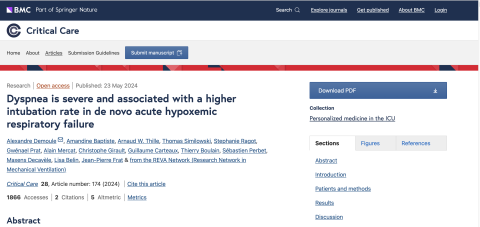
Dyspnea is severe and associated with a higher intubation rate in de novo acute hypoxemic respiratory failure. Alexandre Demoule, Amandine Baptiste, Arnaud W. Thille, Thomas Similowski, Stephanie Ragot, Gwénael Prat, Alain Mercat, Christophe Girault, Guillaume Carteaux, Thierry Boulain, Sébastien Perbet, Maxens Decavèle, Lisa Belin, Jean‑Pierre, Frat. Critical Care(2024) 28:174
Question évaluée :
La dyspnée est-elle associée à un risque accru d'intubation et de mortalité ?
Type d’étude :
Il s’agit d’une étude post hoc de l’étude FLORALI (1), qui comparait l'oxygénothérapie standard (O2 standard), l'oxygénothérapie à haut débit nasal (OHD), et la ventilation non invasive (VNI) dans l’insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique.
Population étudiée :
310 patients atteints d’insuffisance respiratoire aiguë de novo ont été inclus dans l’étude.
Méthode :
Les patients ont évalué l'intensité de leur dyspnée à l'aide d'une échelle visuelle analogique de 100 mm (EVAdyspnée), il leur a été demandé de mesurer leur inconfort respiratoire. Cette évaluation a été réalisée à l'inclusion, sous masque à haute concentration, puis une heure après le début du traitement attribué (O2 standard, OHD ou VNI). L’inconfort lié à l'interface respiratoire n’était pas évalué.
Les patients ont été répartis en quatre groupes selon leur niveau de dyspnée (2) :
- Pas de dyspnée (EVAdyspnée < 16 mm)
- Dyspnée légère (16-39 mm),
- Dyspnée modérée (40-64 mm)
- Dyspnée sévère (≥ 65 mm)
Résultats essentiels :
L'EVAdyspnée médiane initiale était de 46 mm (16-65), avec 17 % de dyspnée légère, 32 % modérée, et 24 % sévère. Après 1 heure de traitement, elle a diminué à 35 mm (10-56), avec 22 % de dyspnée légère, 30 % modérée, et 17 % sévère.
Facteurs associés à une dyspnée modérée à sévère à l’inclusion et après 1h de traitement :
- A l’inclusion, dans l'analyse multivariée, trois facteurs ont été indépendamment associés à un risque réduit de dyspnée modérée à sévère (EVAdyspnée ≥ 40 mm) : le tabagisme (OR 0,39, IC 95% 0,22-0,69), l'immunosuppression (OR 0,48, IC95 % : 0,25-0,92) et un score McCabe ≥2 (OR 0,32, IC95 % : 0,16-0,65).
- A 1h de traitement, l'analyse multivariée a retrouvé six facteurs indépendamment associés à une dyspnée modérée à sévère. Quatre facteurs était associés à un risque augmenté de dyspnée modérée à sévère : un âge > 60 ans (OR 2,17, IC95 % 1,20-3,90), la pression artérielle systolique (PAS) (OR pour chaque augmentation de 10 points : 1,13, IC95 % 0,98-1,30), la fréquence respiratoire (OR pour chaque augmentation de 10 points : 1,43, IC 95 % : 0,96-2,13) et les infiltrats pulmonaires bilatéraux (OR 3,08, IC95 % 1,42-6,65). À l'inverse, deux facteurs ont été associés à un risque réduit de dyspnée modérée à sévère : l'immunosuppression (OR 0,49, IC95 % 0,25-0,97) et l'utilisation de l'OHD (OR 0,57, IC95 % 0,34-0,95).
Après 1 heure de traitement, seule l’OHD a permis d’améliorer la dyspnée comparée aux deux autres traitements.
Association entre dyspnée et intubation
Le taux d'intubation était de 45 % (n = 115).
Trois facteurs ont été associés à un risque augmenté d'intubation : une dyspnée modérée ou sévère à l’inclusion (sHR 1,96, IC95 % 1,07-3,57 et sHR 2,61, IC95% 1,40-4,87), une PAS entre 120 et 140 mmHg à l’inclusion (sHR 2,56, IC95 % 1,58-4,17), et une fréquence cardiaque > 100 battements/min à l’inclusion (sHR 1,94, IC 95 % : 1,29-2,92). En revanche, un rapport PaO2/FiO2 ≥ 200 mmHg à l’inclusion (sHR 0,34, IC95 % 0,15-0,76) a été associée à un risque réduit d'intubation.
L'incidence cumulée d’intubation était plus élevée chez les patients présentant une dyspnée modérée à sévère au départ, comparativement à ceux sans dyspnée ou avec une dyspnée légère (p = 0,0004).
Les variables mesurées 1 h après le début du traitement qui étaient associées à un risque plus élevé d'intubation étaient la dyspnée sévère, une fréquence respiratoire élevée, une pression artérielle élevée, une fréquence cardiaque élevée.
Un rapport PaO2/FiO2 augmenté 1 h après le début du traitement était associé à un risque plus faible d'intubation.
Associations entre dyspnée initiale et mortalité
La mortalité en réanimation était de 18 % (n = 46), et la mortalité à J90 de 20 % (n = 53).
La mortalité à J90 était de 16 % chez les patients sans dyspnée, 16 % avec une dyspnée légère, 20 % avec une dyspnée modérée, et 31 % avec une dyspnée sévère (p = 0,110).
La probabilité cumulative de survie était plus faible chez les patients ayant une EVA dyspnée initiale ≥ 40 mm (p = 0,049).
Commentaires :
Dans cette étude évaluant la dyspnée des patients admis en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique de novo, les résultats montrent que :
- L'intensité de la dyspnée au départ était élevée.
- Une dyspnée modérée à sévère au départ était associée à un risque accru d'intubation.
- Une dyspnée modérée à sévère était également associée à une augmentation de la mortalité à J90.
Contrairement aux signes de détresse respiratoire observés cliniquement, la dyspnée est un symptôme que seul le patient peut décrire. Tout comme la douleur, elle doit être détectée, prise en compte, et soulagée rapidement. En effet, une EVA dyspnée ≥ 30/100 mm est considérée comme inacceptable par un tiers des patients (3).
Points forts :
- Etude ancillaire sur une étude princeps multicentrique de grande envergure dont les critères d’intubation prédéfinis n’incluaient pas la dyspnée (1)
- Collecte prospective des données de l’évaluation de la dyspnée
- Peu d’étude s’intéressant à ce symptôme (4,5)
Points faibles :
- Evaluation de la dyspnée à deux moments uniquement : à l’inclusion et après 1h de traitement.
- Le délirium n’était pas évalué dans cette étude, seuls les patients capables d’évaluer leur dyspnée étaient évalués : environ 15% des patients n’ont pas pu évaluer leur dyspnée.
- La question posée pour évaluer la dyspnée était l’inconfort respiratoire qui ne reflète pas exactement la dyspnée. Bien que des termes tels que « essoufflement », « difficulté à respirer » ou « manque d'air » aient pu être utilisés, aucun d'entre eux ne reflète parfaitement la dyspnée.
Implications et conclusions :
Cette étude souligne l'importance de l'évaluation de la dyspnée en réanimation. La dyspnée est fréquente et, lorsqu'elle est modérée à sévère, elle est associée à un risque accru d’intubation et de mortalité. Tout comme la douleur, la dyspnée doit être identifiée, prévenue et soulagée. À l'avenir, il sera essentiel d'étudier non seulement la dyspnée elle-même, mais aussi les stratégies pour la soulager et son impact après la réanimation. Des RFE sur la dyspnée ont été rédigées conjointement par la SRLF et la SFMU en 2024 et vont être publiées prochainement. Ces RFE vont permettre d’aider à l’identification, la caractérisation et la prise en charge de la dyspnée en réanimation.
Références cités dans les commentaires:
- Frat JP, Thille AW, Mercat A, Girault C, Ragot S, Perbet S, et al. High-Flow Oxygen through Nasal Cannula in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. N Engl J Med. 2015 Jun 4;372(23):2185–96.
- Demoule A, Decavele M, Antonelli M, Camporota L, Abroug F, Adler D, et al. Dyspnoea in acutely ill mechanically ventilated adult patients: an ERS/ESICM statement. Intensive Care Med. 2024 Feb;50(2):159–80.
- Rotondi AJ, Chelluri L, Sirio C, Mendelsohn A, Schulz R, Belle S, et al. Patients’ recollections of stressful experiences while receiving prolonged mechanical ventilation in an intensive care unit. Crit Care Med. 2002 Apr;30(4):746–52.
- Menga LS, Grieco DL, Rosà T, Cesarano M, Delle Cese L, Berardi C, et al. Dyspnoea and clinical outcome in critically ill patients receiving noninvasive support for COVID-19 respiratory failure: post hoc analysis of a randomised clinical trial. ERJ Open Res. 2021 Oct;7(4):00418–2021.
Frat JP, Quenot JP, Badie J, Coudroy R, Guitton C, Ehrmann S, et al. Effect of High-Flow Nasal Cannula Oxygen vs Standard Oxygen Therapy on Mortality in Patients With Respiratory Failure Due to COVID-19: The SOHO-COVID Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022 Sep 27;328(12):1212–22.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Article commenté par le Dr Mai-Anh NAY Praticienne Hospitalière Service de Médecine Intensive Réanimation, Centre Hospitalier Universitaire d'Orléans.
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Envoyez vos commentaires/réactions à mai-anh.nay@chu-orleans.fr et à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
C. DUPUIS
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
G. FOSSAT
N. HIMER
T. KAMEL
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
V. ZINZONI