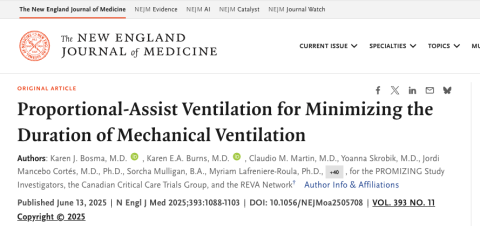
Bosma KJ, Burns KEA, Martin CM, Skrobik Y, Mancebo Cortés J, Mulligan S, Lafreniere-Roula M, Thorpe KE, Suárez Montero JC, Morán Chorro I, Rodríguez-Farré N, Butler R, Bentall T, Beduneau G, Enguerrand P, Santos M, Piraino T, Spadaro S, Montanaro F, Basmaji J, Campbell E, Mercat A, Beloncle FM, Carteaux G, Maraffi T, Charbonney E, Lecronier M, Dres M, Arabi YM, Amaral ACK, Marinoff N, Adhikari NKJ, Geagea A, Shin P, Vaporidi K, Kondili E, Shahin J, Campisi J, Rodriguez PO, Setten M, Goligher EC, Ferguson ND, Fanelli V, Ferreyra G, Lellouche F, Sibley S, Brochard L; PROMIZING Study Investigators, the Canadian Critical Care Trials Group, and the REVA Network. Proportional-Assist Ventilation for Minimizing the Duration of Mechanical Ventilation. N Engl J Med. 2025 Jun 13. doi: 10.1056/NEJMoa2505708. Epub ahead of print. PMID: 40513024.
Question évaluée
L’objectif de cette étude est d’évaluer si l’utilisation de la ventilation assistée proportionnelle (PAV+), dès la phase de transition de la ventilation contrôlée à la ventilation assistée et jusqu’au sevrage ventilatoire, permet de réduire la durée de ventilation mécanique.
Le mode de ventilation assistée le plus largement utilisé dans le monde est la ventilation spontanée avec aide inspiratoire (VSAI). L’assistance est fixe et réglée en cmH2O sous la forme d’une aide inspiratoire, qui correspond à la pression positive au-dessus de la PEP maintenue par le ventilateur pendant toute la durée de l’insufflation, quelque soit l’intensité et la durée de l’effort du patient. Ce mode expose le patient au risque de sous-assistance mais aussi de sur-assistance (risque d’atrophie diaphragmatique et d’asynchronies), associées à un allongement de la durée de ventilation.
La ventilation assistée proportionnelle avec ajustement automatisé du gain (PAV+) est un mode durant lequel l’assistance est directement proportionnelle à l’effort du patient (plus l’effort du patient est important, plus l’assistance fournie par le ventilateur est élevée). L’assistance est réglée sous la forme d’un gain qui représente le pourcentage de la pression totale nécessaire à l’insufflation pris en charge par le ventilateur. En effet, selon l’équation de mouvement du système respiratoire, la pression totale nécessaire à l’insufflation du volume courant à chaque instant (t) de l’insufflation est égale à :
Ptot(t) = Pvent(t) + Pmus (t) = PEP + RRS x V’(t) + CRS/V(t)
(Ptot : pression totale, Pvent : pression du ventilateur, Pmus : pression musculaire, PEP : pression expiratoire positive, RRS : résistance du système respiratoire, V’ : débit d’insufflation, CRS : compliance du système respiratoire, V : volume insufflé)
Grâce à des micro-occlusions télé-inspiratoires et -expiratoires régulières, le ventilateur mesure automatiquement la résistance et la compliance du système respiratoire. PEP, débit et volume étant connu, le ventilateur calcule donc la pression totale nécessaire à chaque cycle et grâce à une boucle de rétro-contrôle très rapide, il adapte son niveau d’assistance pour assurer un certain pourcentage (le fameux gain !) de cette pression totale. Si le gain est réglé à 60%, alors le ventilateur fait 60% du travail et le patient les 40% restant. Ainsi l’assistance est directement proportionnelle à la pression musculaire du patient :
Pvent(t) = Pmus(t) x Gain/(1-Gain)
Et la synchronisation est théoriquement parfaite puisque lorsque le patient arrête son effort (Pmus = 0), le ventilateur arrête d’insuffler.
Enfin, en retournant l’équation, on peut calculer la Pmus au lit du patient
Pmus = Pvent* x (100 – Gain)/Gain
*Pvent = pression maximale à l’insufflation – PEP
et il a été montré qu’un ajustement quotidien du gain selon cet algorithme permettait de maintenir les patients dans une zone d’effort « normale » (entre 5 et 10 cmH2O de Pmus), c’est-à-dire sans sur- ni sous-assistance (1).
Si les effets bénéfiques physiologiques de la PAV+ (notamment sur la dyspnée et les asynchronies) ont déjà été démontrés, son bénéfice clinique reste à prouver.
Type d’étude
Il s’agit d’un essai contrôlé, randomisé, multicentrique (23 hôpitaux sur 4 continents), en ouvert.
Population étudiée
Les patients majeurs nécessitant au moins 24 heures de ventilation invasive étaient éligibles. Etaient exclus, les patients moribonds, les atteintes neurologiques centrales ou neuromusculaires sévères (afin de ne pas inclure des patients avec une inadéquation entre le drive et l’effort respiratoire, rendant le fonctionnement de la PAV+ moins pertinent), les fistules bronchopleurales (les fuites faussant les mesures de mécanique nécessaires à la PAV+), les BPCO sévères et les patients trachéotomisés à l’admission en réanimation.
L’originalité de cette étude est d’avoir ciblé les patients entrant dans la phase de transition (2,3), c’est-à-dire pouvant tolérer la ventilation assistée depuis moins de 24 heures (capables de tenir > 30 min en VSAI avec une aide maximale de 20 cmH2O et une FiO2 maximale de 60%), mais n’étant pas encore en phase de sevrage (ne remplissant pas les critères de sevrabilité (4) ou échouant une épreuve de ventilation spontanée (EVS)).
Méthode
Dans le bras PAV+, le gain était ajusté quotidiennement pour maintenir la Pmus entre 5 et 10 cmH2O.
Dans le bras VSAI, l’aide inspiratoire était ajustée quotidiennement pour maintenir une fréquence respiratoire entre 12 et 35 /min et un volume courant entre 5 et 10 mL/kg de poids prédit par la taille.
Le retour en ventilation contrôlée et le sevrage ventilatoire (avec un screening quotidien) étaient protocolisés dans les deux bras.
Le critère de jugement principal était le délai entre la randomisation (= entrée en phase de transition) et le sevrage réussi (défini par un patient vivant et sans ventilation invasive à J7 de l’extubation) (5,6).
Résultats essentiels
575 patients ont été randomisés entre 2016 et 2023, dont 284 analysés dans le groupe PAV+ et 286 dans le groupe VSAI. La randomisation a eu lieu après 4.9 [3.1 – 8.9] jours de ventilation invasive.
L’étude est négative sur son critère de jugement principal puisque la PAV+ n’a pas permis de réduire le délai entre la transition vers un mode assisté et l’extubation : 7.3 jours (IC95% 6.2-9.7) en PAV+ vs. 6.8 jours (IC95% 5.4-8.8) en VSAI.
Les critères secondaires (durée de ventilation, difficulté du sevrage, mortalité) sont également négatifs.
Commentaires
Sur 6610 patients potentiellement éligibles, seuls 575 ont été randomisés. 2488 patients n’ont notamment pas été inclus car ils ont réussi une EVS ou ont été extubés au moment de l’évaluation. Cela signifie que près de 40% de nos patients sont déjà extubables lorsqu’on se pose la question de passer de la ventilation contrôlée à la ventilation assistée et que la phase de transition ne concerne donc probablement pas tout le monde.
Cet essai contrôlé randomisé a donc échoué à montrer que les bénéfices physiologiques de la PAV+ pouvaient se traduire en un bénéfice clinique évident. Cependant, la VSAI a sans doute été réglée de manière plus précise qu’en pratique clinique courante. En effet, le protocole de réglage de VSAI était très détaillé avec des objectifs de volume courant et de fréquence respiratoire, ainsi que des adaptions prévues selon la gazométrie. En témoigne d’ailleurs un drive respiratoire estimé par la P0.1 similaire entre les deux groupes (1.8 [1.0-3.0] cmH2O en médiane en PAV+ vs. 2.0 [1.0-3.0] cmH2O en VSAI) et considéré comme désirable (entre 1 et 3.5 cmH2O en valeur absolue) chez la majorité des patients (62%). Cet ajustement rigoureux de la VSAI a peut-être gommé les avantages physiologiques de la PAV+. A noter également que 80.3% des mesures de Pmus réalisées en PAV+ étaient dans la cible alors que seules 62.9% des mesures de P0.1 étaient dans la cible, suggérant une décorrélation entre le drive et l’effort respiratoire chez une partie de la population de l’étude.
Points forts
Nous ne reviendrons pas sur les points forts méthodologiques évidents d’un essai contrôlé randomisé multicentrique.
Cette étude nous apporte dans un premier temps des informations épidémiologiques, physiologiques et cliniques intéressantes sur une phase sous-étudiée de la ventilation invasive : la transition de la ventilation contrôlée à la ventilation assistée.
Bien que le bénéfice clinique de la PAV+ n’ait pas été démontré, le protocole détaillé de réglage de la PAV+ a permis son utilisation en pratique clinique courante (seulement 2.5% de changement de mode), alors qu’il est parfois considéré comme un mode complexe à utiliser et réservé aux experts. A noter cependant un taux de retour en ventilation contrôlée plus important dans le groupe PAV+ (58.9% vs. 49.7% en VSAI), sachant que 24% des cliniciens ont trouvé que la PAV+ n’était pas facile à utiliser.
Points faibles
La sélection des patients, qui pourrait aussi être un point fort, est peut-être devenu un point faible. Le processus d’inclusion cherchait à exclure absolument les patients rapidement sevrables ; en effet, on imagine que chez les patients qui passent peu de temps en ventilation assistée, le mode utilisé aura moins d’impact sur le devenir. De fait, les patients inclus dans l’étude semblent être particulièrement difficiles à gérer sur le plan respiratoire : durée de ventilation prolongée (5 jours avant randomisation + 7 jours après), avec des taux de sevrage difficile voire prolongé (49%), d’échec d’extubation (23%) et de trachéotomie (23% !) élevés. Il s’agit donc probablement de patients complexes avec des problématiques extra-respiratoires non influencées par l’intervention (retard de réveil, neuromyopathie de réanimation sévère, troubles métaboliques modifiant le drive respiratoire…).
De plus, seuls 10.5% des patients étaient encore en ventilation contrôlée au moment de l’inclusion et 88% étaient déjà en VSAI (certes depuis moins de 24h). Il est dommage que la PAV+ n’ait pas été le seul mode utilisé dans le bras interventionnel et une intervention plus précoce aurait peut-être pu montrer un effet.
Implications et conclusions
Cette étude ne permet donc pas de recommander l’utilisation de la PAV+ plus que de la VSAI comme mode de ventilation assistée. En revanche, elle souligne l’importance de disposer de protocoles rigoureux de réglage de l’assistance respiratoire, quel que soit le mode de ventilation assistée utilisé, et de sevrage ventilatoire.
A noter qu’à l’heure actuelle, le seul fabricant qui proposait le mode PAV+ a arrêté la production de ventilateurs…
Références citées dans les commentaires :
- Carteaux G, Mancebo J, Mercat A, Dellamonica J, Richard JCM, Aguirre-Bermeo H, et al. Bedside adjustment of proportional assist ventilation to target a predefined range of respiratory effort. Crit Care Med. sept 2013;41(9):2125‑32.
- Demoule A. The transition phase between controlled mechanical ventilation and weaning is our next great cause. Current Opinion in Critical Care. févr 2025;31(1):1.
- Haudebourg AF, Chantelot L, Nemlaghi S, Haudebourg L, Labedade P, Boujelben MA, et al. Factors influencing the transition phase in acute respiratory distress syndrome: an observational cohort study. Annals of Intensive Care. 2025;In Press.
- Boles JM, Bion J, Connors A, Herridge M, Marsh B, Melot C, et al. Weaning from mechanical ventilation. Eur Respir J. mai 2007;29(5):1033‑56.
- Pham T, Heunks L, Bellani G, Madotto F, Aragao I, Beduneau G, et al. Weaning from mechanical ventilation in intensive care units across 50 countries (WEAN SAFE): a multicentre, prospective, observational cohort study. The Lancet Respiratory Medicine. 1 mai 2023;11(5):465‑76.
- Béduneau G, Pham T, Schortgen F, Piquilloud L, Zogheib E, Jonas M, et al. Epidemiology of Weaning Outcome according to a New Definition. The WIND Study. Am J Respir Crit Care Med. 15 mars 2017;195(6):772‑83.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Commenté par : Anne-Fleur Haudebourg, Médecine Intensive Réanimation, CHU Henri Mondor (AP-HP), Créteil, France.
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Voir les déclarations de conflits d'intérêt (titre cliquable): Anne-Fleur HAUDEBOURG
Envoyez vos commentaires/réactions à annefleur.maignant@aphp.fr et à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
A.CAILLET
C. DUPUIS
N. FAGE
JP. FRAT
G. FOSSAT
A. GAILLET
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
N. HIMER
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
M. THY