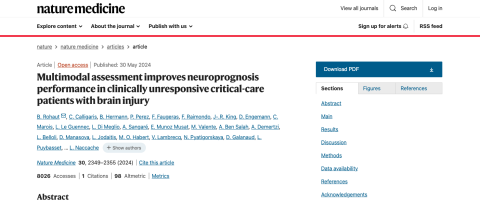
Multimodal assessment improves neuroprognosis performance in clinically unresponsive critical-care patients with brain injury.
B. Rohaut, C. Calligaris, B. Hermann, P. Perez, F. Faugeras, F. Raimondo, J-.R. King, D. Engemann, C. Marois, L. Le Guennec, L. Di Meglio, A. Sangaré1, E. Munoz Musat, M. Valente, A. Ben Salah, A. Demertzi, L. Belloli, D. Manasova, L. Jodaitis, M. O. Habert, V. Lambrecq, N. Pyatigorskaya, D. Galanaud, L. Puybasset, N. Weiss, S. Demeret, F. X. Lejeune, J. D. Sitt & L. Naccache.
Nat Med. 2024 May 30. doi: 10.1038/s41591-024-03019-1
Question évaluée
Une évaluation multimodale (MultiModal Assessment - MMA) associant des paramètres cliniques, d’imagerie et de neurophysiologie permet-elle de réduire le niveau d’incertitude pronostique chez des patients ayant un trouble de conscience persistant après une agression cérébrale aiguë ?
Type d’étude
Etude rétrospective de données collectées prospectivement, monocentrique sur 12 ans (2009-2021) dans un centre tertiaire français expert en neuro-réanimation.
Population étudiée
Critères d’inclusion :
- Patients de 18 à 80 ans,
- Ayant un trouble de conscience persistant à la phase subaigüe ou chronique, adressés en Médecine Intensive Réanimation (MIR) à orientation neurologique pour évaluation du pronostic neurologique,
- Agression cérébrale aiguë documentée par un scanner (TDM) ou une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale, pouvant être d’origine variée : secondaire à un arrêt cardiorespiratoire (ACR), un traumatisme crânien (TC), un accident vasculaire cérébral (AVC), une encéphalite ou encéphalopathie, une hypoglycémie.
Critères d’exclusion :
- Patients profondément sédatés
- Antécédents de maladie neurodégénérative
- Grossesse
Méthode
La MMA associait :
- Une évaluation clinique quotidienne réalisée par un clinicien expérimenté, à l’aide de l’échelle CRS-r et du FOUR score (implémenté en 2011). L’échelle CRS-r comporte 23 items répartis en 6 catégories (fonctions auditives, visuelles, motrices, verbales, de communication et d’éveil). Les différents états de conscience (coma, état végétatif (vegetatif state – VS), état de conscience minimal (minimally conscious state – MCS, dichotomisé en MCS- ou MCS+ en fonction de l’existence ou non d’un schéma de communication verbale possible avec le patient) ou sortie de l’état de conscience minimal (Emergence MCS - EMCS)) étaient définis en fonction du meilleur score obtenu ;
- Un électroencéphalogramme (EEG) intermittent de 12 électrodes (avec évaluation de la réactivité EEG) et éventuellement des potentiels évoqués somesthésiques (réponses N20) ;
- Un EEG haute résolution (EEG-HR à 256 électrodes) associé à différents paradigmes de stimulations auditives (dont le paradigme « local-global »). Ces outils permettent d’enregistrer différentes réponses en potentiels évoqués auditifs tardifs (également appelés event-related potential - ERPs ou potentiels évoqués cognitifs) : la N100, la mismatch negativity (MMN, correspondant au local effect), la P300 (avec les composantes P3a et P3b, cette dernière correspondant au global effect). Ces différentes réponses reflètent les réponses corticales (conscientes ou inconscientes) induites par la nouveauté acoustique présente au sein du paradigme auditif utilisé ;
- L’EEG-HR permettait également une analyse quantitative du signal EEG (qEEG) évaluant : la puissance spectrale (modifications de puissance du signal EEG dans les différentes bandes de fréquence au cours du temps), la complexité du signal EEG et la connectivité fonctionnelle entre les différentes structures cérébrales (implémenté en 2015) ;
- Un protocole évaluant la réponse cérébrale induite par la commande motrice (motor-command protocol). Ces réponses cérébrales observées en EEG-HR permettent de détecter des signes de dissociation cognitivo-motrice (cognitive motor dissociation-CMD), exprimant la dissociation entre un dysfonctionnement comportemental moteur et des fonctions cognitives supérieures préservées (implémenté en 2021) [1] ;
- Des techniques d’imagerie morphologiques : scanner et IRM, incluant une séquence diffusion tensor imaging – DTI, permettant la mesure de la fraction d’anisotropie (FA) qui évalue les lésions des fibres longues de substance blanche (implémentées en 2015) ;
- Des techniques d’imageries fonctionnelles : IRMf de repos (resting state) et la TEP- scanner, ajoutées en 2013 et 2016, respectivement. Ces deux techniques permettent en particulier de différentier les patients VS et MCS.
Un comité pluridisciplinaire expert dans l’évaluation des troubles de conscience (incluant réanimateurs, neurologues, neurophysiologistes, neuroradiologues et neuroscientifiques), appelé Disorder of Consciousness - DoC Team, estimait ensuite le pronostic de façon consensuelle comme : favorable (amélioration substantielle prévisible de l’état de conscience du patient) , défavorable (absence d’amélioration substantielle prévisible) ou incertain (degré d’incertitude ne permettant pas d’évaluer le pronostic de manière fiable) .
Le critère de jugement principal était l’évolution neurologique à 1 an selon la Glasgow Outcome Scale – Extended (GOS-E ; GOSE 1 : décès ; GOSE 2 : état végétatif ; GOSE 3 : handicap sévère – niveau inférieur ; GOSE 4 : handicap sévère – niveau supérieur ; GOSE 5 : handicap modéré - niveau inférieur ; GOSE 6 : handicap modéré – niveau supérieur ; GOSE 7 : bonne récupération –niveau inférieur ; GOSE 8 : bonne récupération – niveau supérieur). La GOSE était évaluée par un entretien téléphonique en aveugle de la conclusion de la MMA. L’évolution neurologique était dichotomisée en GOSE ≥ 4 (évolution favorable) ou < 4 (défavorable).
Résultats essentiels
Entre 2009 et 2021, 349 patients ont bénéficié d’une évaluation multimodale (MMA). Le pronostic à 1 an était disponible chez 277/349 patients (79%). Il s’agissait de patient de 53 ans d’âge médian, majoritairement des hommes (64%). Le délai médian entre l’atteinte cérébrale aiguë et l’évaluation multimodale était de 33 (23-53) jours. Les causes étaient variées, dominées par l’anoxie (36%), le TC (19%) et l’AVC (14%). Concernant la sévérité du trouble de conscience (classé du plus au moins sévère), on notait un coma dans 3%, un état végétatif (VS) dans 42%, un état de conscience minimal (MCS) dans 46%, et une émergence du MCS dans 9%. Le nombre de modalités d’évaluation augmentait de 4 à 12 examens durant la période de l’étude.
A 1 an, 16,6% présentaient un pronostic fonctionnel favorable. Les facteurs indépendamment associés à un pronostic favorable étaient un âge plus jeune (38,4 vs 54,6 ans, p = 0,0002), l’absence d’antécédent médical (42,2% vs 24,9%, p = 0,028) et la cause traumatique (37% vs 11,3%, p = 6,3x10-5), alors que l’étiologie anoxique était associée à un potentiel de récupération moindre (26,1% vs 42,9%, p = 0,047). Concernant l’association entre la sévérité du trouble de conscience et l’évolution neurologique, les patients MCS étaient plus susceptibles d’avoir un pronostic favorable à 1 an, comparé aux patients VS (19,3% vs 3,4%, respectivement).
Dans la cohorte globale (n=277), le pronostic était prédit par la MMA comme favorable, incertain ou défavorable dans respectivement 22%, 45,5% et 32,5% des cas. Il existait une association entre la prédiction basée sur la MMA et le pronostic fonctionnel à 1 an : si le pronostic était jugé favorable, la probabilité d’avoir un bon pronostic à 1 an était plus élevée en comparaison à un pronostic jugé mauvais (OR 26,76 (95% CI, 11,88-64,39), p < 0,001) ou incertain (OR 3,45 (95% CI, 1.92–6.23), p< 0.001). Pour autant, environ 63,7% et 79,4% des patients dont le pronostic était prédit comme respectivement favorable et incertain présentaient finalement une évolution défavorable. Enfin, tous les patients pour lesquels le pronostic était jugé défavorable présentaient finalement une évolution péjorative.
Concernant la performance pronostique individuelle de ces différents marqueurs, la valeur prédictive positive (VPP) pour prédire l’évolution favorable restait relativement modeste (entre 10 et 31%, selon les marqueurs). En revanche, la valeur prédictive négative (VPN) de ces différents marqueurs était excellente pour la majorité d’entre eux (variant de 85 et 100%). Aucun de ces marqueurs pris individuellement ne présentait de meilleures performances pronostiques que la discussion pluridisciplinaire de la DoC-Team basée sur la MMA.
Pour limiter le risque de biais lié à la prophétie auto-réalisatrice, les mêmes analyses ont été réalisées dans la sous-population de patients (n=179) pour qui aucune décision de limitations des thérapeutiques (LAT) n’avait été prise en lien direct avec la MMA, ou pour qui l’existence d’une telle décision n’était pas connue. Les résultats sont relativement similaires à ceux de la cohorte globale.
Concernant l’association entre le nombre de modalités d’évaluation et l’exactitude de la prédiction, on observe que l’augmentation du nombre de modalités d’évaluation était associée à une réduction de l’incertitude pronostique et à une amélioration de la précision pronostique proposée par l’équipe pluridisciplinaire DoC-Team.
Commentaires
Dans cette cohorte de patient à la phase subaigüe d’un trouble de conscience lié à une agression cérébrale majoritairement anoxique, traumatique ou vasculaire, une approche multimodale permet de réduire le niveau d’incertitude pronostique.
Bien que les recommandations soulignent déjà la valeur ajoutée d’une approche multimodale pour évaluer le pronostic neurologique [2,3], il s’agit ici de la première étude à évaluer l’intérêt de la multi-modalité dans une population particulière de patients présentant un trouble de conscience à 33 jours de l’agression cérébrale aigue. Cette cohorte, bien que relativement hétérogène, comporte environ un tiers de patients en post ACR. Chez ces patients, les outils pronostiques sont actuellement bien connus à la phase aiguë (marqueurs collectés entre 24h et 7 jours post ACR) [4], mais restent moins bien définis à la phase subaigüe ou chronique de l’agression cérébrale anoxique, d’où l’intérêt de cette étude. Concernant les autres étiologies d’agression cérébrale, les marqueurs tels que l’examen clinique, la TDM, l’IRM morphologique et les outils de neurophysiologie jouent également un rôle fondamental, bien que leurs valeurs pronostiques soient inférieures à celles observées dans l’ACR [5]. Ainsi, les techniques émergentes telles que les potentiels évoqués auditifs tardifs, les analyses quantitatives de signal EEG (qEEG), l'IRM morphologique avec séquence DTI – FA et l’IRM fonctionnelle offrent une double approche d’évaluation fonctionnelle et structurelle de l’atteinte cérébrale. Cette étude est la première à inclure nombre de ces modalités novatrices d’évaluation. Ainsi, elle permet d’identifier des marqueurs pronostiques prometteurs en post TC, AVC, encéphalites ou encéphalopathies. Elle confirme également que le potentiel de récupération est meilleur en cas d’agression cérébrale traumatique comparé à la cause anoxique. Les autres étiologies étant sous représentées, il n’était pas possible pour les auteurs de proposer des analyses en sous-groupe par type d’agression cérébrale.
Il faut également souligner que cette évaluation multimodale était particulièrement performante pour prédire l’évolution défavorable, alors que les performances de la MMA pour prédire l’évolution favorable étaient limitées. Ainsi, 36,4% des patients dans le groupe « bon pronostic prédit par la DoC-Team » présentaient un handicap sévère à 1 an (GOS-E 3). Cela peut s’expliquer par la sélection d’une population de patients particulièrement sévères, dont seulement 16,6% présentent une évolution neurologique favorable à 1 an.
L’étude s’étendant sur 12 ans, les nouvelles techniques électrophysiologiques et d’imagerie développées par l’équipe investigatrice ont été incorporées à la MMA au fil des années. En conséquence, les patients n’ont pas tous eu la même stratégie d’évaluation. Néanmoins, l’augmentation du nombre de modalités était corrélée à une diminution de l’incertitude pronostique. Ce résultat va à l’encontre de l’idée que, plus le nombre de marqueurs collectés est important, plus le risque de discordance entre eux augmentent, créant ainsi un risque que la neuro-pronostication soit rendu plus difficile [6]. A noter, il était nécessaire d’obtenir au moins 6 modalités pronostiques pour réussir à différentier de manière significative les patients présentant un pronostic « évaluable » (qu’il soit prédit favorable ou défavorable) de « non évaluable/incertain ». Ce résultat souligne la difficulté d’évaluation du pronostic dans cette population de cas particulièrement complexes. Ainsi, l’accès aux outils de première ligne tel que l’EEG, les potentiels évoqués, l’IRM et les biomarqueurs de lésions neuronales (non utilisés dans cette étude car performants en cas de recueil à 48-72h de l’agression cérébrale) dans les différentes réanimations en France est un enjeu majeur [7–9]. Cet accès facilité aux différentes modalités pronostiques devra s’accompagner de la mise en place d’un réseau de soin à l’échelle nationale, permettant une collaboration étroite entre les réanimations de première ligne et les centres experts de second recours.
Points forts
- Analyse rétrospective de données collectées prospectivement monocentrique menée par une équipe multidisciplinaire experte reconnue à l’échelle internationale ;
- Recherche translationnelle avec implication directe pour la prise en charge des patients de soins critiques
- Approche multimodale à l’aide d’échelles validées (CRS-r et FOUR score) et d’outils particulièrement innovants (EEG quantitatif, potentiels évoqués auditifs avec utilisation du paradigme local effet, global effect et cognitive motor dissociation, IRM avec séquence DTI - FA, IRM fonctionnelle et TEP-scanner cérébral) ;
- Evaluation d’outils pronostiques chez des patients à la phase subaigüe d’un trouble de conscience, population pour laquelle peu de marqueurs sont actuellement validés ;
- Evaluation d’outils pronostiques dans différentes étiologies d’agression cérébrale aiguë ;
- Analyse de la sous-population pour laquelle une LAT n’avait a priori pas été décidée, limitant en partie le risque de prophétie auto-réalisée.
Points faibles
- Les performances pronostiques des différentes modalités pour prédire l’évolution favorable restaient limitées, probablement en rapport avec la sélection de la population incluse (trouble de conscience à 33 jours en médiane de l’agression initiale) ;
- L’évolution favorable était définie comme un GOSE ≥ 4, incluant un handicap sévère – niveau supérieur (patient qui peut rester seul > 8h mais incapable de sortir seul sans assistance), définition qui peut être soumise à discussion en fonction de l’appréciation individuelle du patient, de ses directives anticipées et de la qualité de son environnement ;
- La plupart des modalités (en particulier les examens neurophysiologiques et d’imagerie) nécessitaient un post-traitement important après l’acquisition des examens, afin de limiter les artéfacts et de générer les réponses pronostiques ;
- L’accès à ces techniques reste actuellement limité en France ;
- Le nombre d'observations était limité pour certaines modalités (IRM fonctionnelle de repos et potentiels évoqués somesthésiques par exemple).
Implications et conclusions
Chez des patients présentant un trouble de conscience à la phase subaigüe d’une agression cérébrale primaire, une évaluation multimodale incluant des modalités cliniques, neurophysiologiques et d’imagerie novatrices réduit l’incertitude pronostique. La généralisation d’une telle démarche fait face à de nombreux défis organisationnels, nécessitant l’accès facilité aux outils pronostiques de première ligne et la mise en place d’un réseau de soin entre service de réanimation de premier et second recours, afin d’améliorer la prise en soin globale de ces patients.
Références citées dans les commentaires :
- Claassen J, Doyle K, Matory A, Couch C, Burger KM, Velazquez A, et al. Detection of Brain Activation in Unresponsive Patients with Acute Brain Injury. N Engl J Med 2019;380:2497–505. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1812757.
- Kondziella D, Bender A, Diserens K, van Erp W, Estraneo A, Formisano R, et al. European Academy of Neurology guideline on the diagnosis of coma and other disorders of consciousness. Eur J Neurol 2020;27:741–56. https://doi.org/10.1111/ene.14151.
- Giacino JT, Katz DI, Schiff ND, Whyte J, Ashman EJ, Ashwal S, et al. Practice guideline update recommendations summary: Disorders of consciousness: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology; the American Congress of Rehabilitation Medicine; and the National Institute on Disability, Independent Living, and Rehabilitation Research. Neurology 2018;91:450–60. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000005926.
- Nolan JP, Sandroni C, Böttiger BW, Cariou A, Cronberg T, Friberg H, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2021: Post-resuscitation care. Resuscitation 2021;161:220–69. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.012.
- Fischer D, Edlow BL. Coma Prognostication After Acute Brain Injury: A Review. JAMA Neurol 2024. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2023.5634.
- Rohaut B, Claassen J. Decision making in perceived devastating brain injury: a call to explore the impact of cognitive biases. Br J Anaesth 2018;120:5–9. https://doi.org/10.1016/j.bja.2017.11.007.
- Maciel CB, Barden MM, Youn TS, Dhakar MB, Greer DM. Neuroprognostication Practices in Postcardiac Arrest Patients: An International Survey of Critical Care Providers. Crit Care Med 2020;48:e107–14. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000004107.
- Benghanem S, Pelle J, Cariou A. Biomarkers for neuroprognostication: The time has come for the new wave. Resuscitation 2023;193:110028. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.110028.
- Benghanem S, Pruvost-Robieux E, Bouchereau E, Gavaret M, Cariou A. Prognostication after cardiac arrest: how EEG and evoked potentials may improve the challenge. Ann Intensive Care 2022;12:111. https://doi.org/10.1186/s13613-022-01083-9.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Article Commenté par Sarah BENGHANEM (PH) et Antoine BOIS (CCA), Médecine Intensive - Réanimation, Hôpital Cochin, APHP. Centre, Paris, France.
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Envoyez vos commentaires/réactions à sarah.benghanem@aphp.fr et à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
C. DUPUIS
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
G. FOSSAT
N. HIMER
T. KAMEL
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
V. ZINZONI