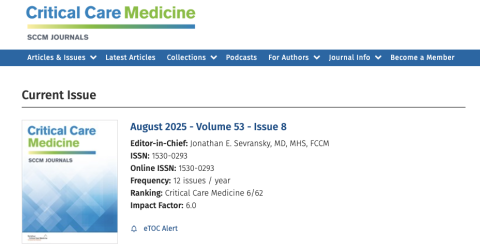
McCloskey CG, Hatton KW, Furfaro D, Engoren M. Obesity Is Associated With Increased Mortality in Patients Undergoing Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation. Crit Care Med. 2025 Mar 1;53(3):e567-e574. doi: 10.1097/CCM.0000000000006547. Epub 2024 Dec 17. PMID: 39688451.
Question évaluée :
L’obésité est-elle associée à une augmentation de la mortalité et des complications chez les patients sous ECMO-VA ?
Type d’étude
Analyse rétrospective multicentrique basée sur le registre de l’Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) entre 2015 et 2021.
Population étudiée
Les patients adultes ayant nécessité une assistance par ECMO-VA entre 2015 et 2021 dans des centres participants au registre ELSO ont été inclus.
Méthode
La mortalité hospitalière constituait le critère de jugement principal.
Analyses statistiques
Les comparaisons statistiques ont été effectuées selon les méthodes conventionnelles : le test du Chi² pour les variables qualitatives, et les tests t de Student ou l’ANOVA pour les variables quantitatives.
Des régressions logistiques multivariées, ajustées sur divers paramètres démographiques, hémodynamiques, respiratoires, microbiologiques, ainsi que sur la durée de l’ECMO, ont été utilisées pour explorer les associations entre l’IMC, la mortalité hospitalière et d’autres complications.
En raison de la non-linéarité anticipée entre l’IMC et les différents critères de jugement, la variable IMC a été modélisée à l’aide de polynômes fractionnaires. Plusieurs puissances ont été testées (S = –2, –1, –0,5, 0, 0,5, 1, 2, 3), avec IMC⁰ correspondant à log(IMC). En complément, la surface corporelle et l’IMC catégorisé selon les six classes de l’OMS — allant de l’insuffisance pondérale (< 18,5 kg/m²) à l’obésité de classe III (> 40,0 kg/m²) — ont également été pris en compte afin de mieux caractériser les relations, potentiellement non linéaires, entre l’IMC et les issues cliniques.
Afin de limiter le risque d’erreurs de type I dans l’évaluation des complications, un seuil de significativité renforcé (p < 0,01) a été adopté.
Résultats essentiels
Au final, 22 825 patients étaient inclus.
L’augmentation de la classe d’obésité était associée à une hausse progressive de la mortalité hospitalière, passant de 47 % chez les patients en insuffisance pondérale à 65 % chez les patients en obésité classe 3 (p < 0,001).
Après ajustement, l’IMC³ était significativement associé à la mortalité (OR = 1.000005 ; IC 95 % : 1.000003–1.000006 ; p < 0,001).
Par rapport à un IMC de 25 kg/m² :
IMC 35 kg/m² → OR = 1,15 (IC 95 % : 1,09–1,18)
IMC 45 kg/m² → OR = 1,46 (IC 95 % : 1,25–1,57)
IMC 55 kg/m² → OR = 2,12 (IC 95 % : 1,57–2,47)
L’analyse des complications mettait en évidence une relation significative entre l’IMC et plusieurs événements indésirables. La prévalence des hémorragies augmentait avec l’IMC, passant de 21 % chez les patients normopondéraux (IMC 18,5 - 25 kg/m²) à 25 % en obésité classe 3 (>40 kg/m²) (p = 0,002). De même, les complications neurologiques étaient plus fréquentes chez les patients obèses, atteignant 8 % en obésité classe 1 (IMC 30 - 35 kg/m²) vs. 6 % en poids normal (p < 0,001). L’atteinte rénale avec une élévation significative des taux de créatinine (>3 mg/dL) était retrouvée chez 11 % des patients en obésité classe 3 contre 7 % en poids normal, et un recours accru à l’épuration extrarénale (EER) chez 33 % des patients en obésité classe 3 contre 24 % en poids normal (p < 0,001). Par ailleurs, la fréquence des complications cardiovasculaires suivait une évolution similaire (19 % en obésité classe 3 vs. 13 % en poids normal, p < 0,001), tout comme les troubles métaboliques (11 % en obésité classe 3 vs. 8 % en poids normal, p = 0,003)et l’ischémie des membres (8 % en obésité classe 3 vs. 7% en poids normal, p = 0,033).
En revanche,aucune association significative n’était observée pour les complications mécaniques (p = 0,066),pulmonaires (p = 0,192) et infectieuses(p = 0,175).
Lorsque l’IMC était analysé comme une variable continue, à l’aide de transformations par polynômes fractionnaires, l’augmentation de l’IMC était associée à une majoration du risque pour trois complications spécifiques :
Complications mécaniques → OR = 1.000003 (IC 95 % : 1.00002–1.000005, p < 0,001 pour IMC3; Fig. 2).
Insuffisance rénale sans recours à une EER et IMC-1 → OR = 0.000007 (IC 95 % : 0.0000001–0.03, p < 0,001 pour IMC-1 ; eFig. 3).
Recours à une EER → OR = 2.797 (IC 95 % : 1.983–3.946, p < 0,001 pour Log10(IMC); Fig. 3).
En revanche, le risque de complications pulmonaires (pneumothorax ou hémorragie alvéolaire) diminuait avec l’augmentation de l’IMC (OR, 566; 95% CI, 135–237,048; p < 0.001 pour IMC–0.5).
Aucune association significative n’a été retrouvée pour les autres complications.
Commentaires :
L’étude repose sur une base de données très large issue du registre ELSO et utilise une méthodologie statistique robuste pour analyser l’impact de l’IMC sur la mortalité et les complications des patients sous ECMO-VA. Toutefois, certaines limites doivent être discutées afin de mieux interpréter ces résultats.
Population étudiée : biais potentiels et limites d’extrapolation
L’étude inclut 22 825 patients, ce qui en fait une des cohortes les plus importantes analysées dans ce contexte. Toutefois, les patients obèses sévères (IMC > 40 kg/m²) ne représentent qu’une minorité (7 %), ce qui pourrait limiter la puissance statistique pour cette sous-population. De plus, la sélection des patients sous ECMO ne prend pas en compte le taux d’échec de la canulation, un biais potentiel puisque certains patients obèses jugés non éligibles n’ont pas été inclus.
L’absence de différenciation des types de chocs constitue une limite majeure, car distinguer un choc cardiogénique à bas débit d’un choc vasoplégique pur est essentiel pour optimiser la prise en charge et éviter les erreurs de classification. Un choc mixte cardiogénique-vasoplégique peut aggraver l’instabilité hémodynamique, rendant l’analyse des résultats plus complexe [1]. De plus, les dispositifs d’assistance circulatoire temporaire sont inadaptés lorsque le débit cardiaque est préservé ou augmenté, comme dans le choc vasoplégique ou certaines formes de chocs mixtes [2].
Prise en charge sous ECMO et facteurs non analysés
L’absence de données sur les stratégies spécifiques aux patients obèses sous ECMO-VA est une limite majeure. L’utilisation de protocoles de ventilation protectrice adaptés n’est pas précisée, tout comme le taux de recours à une décharge ventriculaire gauche (IABP, Impella), alors que des données récentes suggèrent un bénéfice significatif de cette approche [3,4]. De plus, l’absence de données sur le sevrage de l’ECMO empêche d’évaluer si les patients obèses rencontrent davantage de difficultés lors du retrait de l’assistance. La durée de support par l’ECMO-VA et de ventilation auraient apporté des éléments clés pour affiner l’interprétation des résultats.
Points forts
Analyse à grande échelle de l’association entre obésité et ECMO-VA
Données issues du registre ELSO
Approche statistique robuste avec prise en compte de la non-linéarité de l’association IMC-mortalité
Points faibles
Absence de caractérisation hémodynamique des patients et de la sévérité du choc
Absence de données sur les stratégies de décharge ventriculaire et de sevrage
Différence significative de prise en charge pré ECMO avec notamment par support mécanique en pré ECMO de 30% chez les normopondéraux contre 38% chez les obèses sévères (p<0.001) sans cause clairement expliquée.
Absence de données concernant les paramètres et modes de ventilation.
Implications et conclusions
Cette étude met en évidence une augmentation progressive de la mortalité et des complications mécaniques et rénales avec l’IMC chez les patients sous ECMO-VA. Ces résultats suggèrent que l’obésité doit être un facteur clé dans l’évaluation de la balance bénéfice/risque de la mise sous ECMO-VA. Toutefois, l’absence de prise en compte du phénotype hémodynamique, des stratégies de prise en charge et de sevrage limite l’interprétation des résultats.
Références cités dans les commentaires :
- Jentzer JC, Berg DD, Chonde MD, Dahiya G, Elliott A, Rampersad P, Sinha SS, Truesdell AG, Yohannes S, Vallabhajosyula S: Mixed Cardiogenic-Vasodilatory Shock. JACC Adv 2025, 4:101432.
- Combes A, Price S, Slutsky AS, Brodie D: Temporary circulatory support for cardiogenic shock. The Lancet 2020, 396:199–212.
- Grandin EW, Nunez JI, Willar B, et al. Mechanical Left Ventricular Unloading in Patients Undergoing Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation. J Am Coll Cardiol 2022;79:1239–50. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.01.032.
- Schrage B, Becher PM, Bernhardt A, et al. Left Ventricular Unloading Is Associated With Lower Mortality in Patients With Cardiogenic Shock Treated With Venoarterial Extracorporeal Membrane Oxygenation: Results From an International, Multicenter Cohort Study. Circulation 2020;142:2095–106.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Article réalisée par Grégoire Del Marmol et Alain Combes, Service de Médecine Intensive et Réanimation, Institut de Cardiologie, Hôpital La Pitié Salpêtrière, Sorbonne Université, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
Voir les déclarations de conflits d'intérêt (titre cliquable): Grégoire Del Marmol
Envoyez vos commentaires/réactions à : la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
A.CAILLET
C. DUPUIS
N. FAGE
JP. FRAT
G. FOSSAT
A. GAILLET
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
N. HIMER
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
M. THY