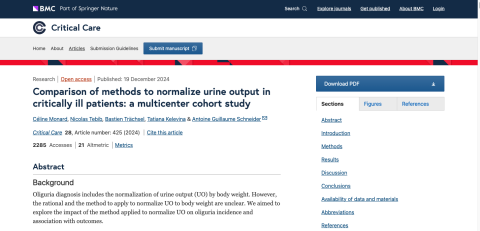
Comparison of methods to normalize urine output in critically ill patients: a multicenter cohort study, Monard et al, Critical Care 2024.
Question évaluée :
L’oligurie est un critère diagnostique de l’insuffisance rénale aiguë (IRA). Elle est définie en normalisant la diurèse sur le poids, sans qu’un consensus clair n’existe quant au poids de référence à utiliser (poids préadmission, poids idéal dérivé de la taille, surface corporelle…). L’objectif de cette étude est de comparer différentes méthodes de normalisation de la diurèse et d’identifier celle la mieux corrélée au pronostic vital et rénal.
Type d’étude :
Étude observationnelle rétrospective multicentrique réalisée sur deux cohortes historiques :
- Cohorte Suisse Laus’AKI (cohorte de dérivation) : patients inclus entre 2010 et 2020.
- Cohorte Américaine MIMIC-IV (cohorte de validation) : patients inclus entre 2008 et 2019.
Population étudiée :
Patients adultes avec un poids et/ou une taille disponible dans la base de données.
Critères d’exclusion :
- Patients dialysés chroniques,
- Mesure de diurèse inférieure à 6 heures consécutives,
- Absence de dosage de créatinine,
- Nécessité d’irrigations vésicales.
Méthode :
L’oligurie était définie par une diurèse < 0.5 mL/kg/h sur 6 h. Le poids réel avant admission (ABW) servait de modèle de référence. En son absence, le quartile inférieur des poids obtenus en réanimation était utilisé ou, à défaut, un poids arbitraire (60 kg pour les femmes et 70 kg pour les hommes).
Critères de jugement cliniques :
- Mortalité à J90,
- Survenue d’une maladie rénale aiguë (diminution du DFG de 35 % ou augmentation de la créatinine de 150 % à la sortie d’hospitalisation).
Trois étapes d’analyse :
- Détermination du meilleur modèle de normalisation de la diurèse (« best urine output (UO) predictor ») en comparant l’Akaike’s Information Criteria (AIC) et le R-squared (R²) du modèle ABW à d’autres méthodes (poids idéal selon quatre formules, poids ajusté [poids idéal selon Devine (IBWd) + 0.4 (ABW - IBWd)], taille, IMC, surface corporelle).
- Comparaison de l’incidence de l’oligurie selon l’ABW et le best UO predictor dans les deux cohortes.
- Régression logistique évaluant l’association entre le best UO predictor et les critères cliniques dans la cohorte de validation, avec comparaison de la performance du modèle ABW via les « area under the receiver operator curve » (AU-ROC) et le pseudo-R² de McFadden.
L’agrément entre les diagnostics d’IRA selon les critères KDIGO de créatinine, l’oligurie avec ABW ou le best UO predictor a également été évalué. Plusieurs analyses de sensibilité excluant les patients sans sonde urinaire ou recevant des diurétiques ont été réalisées.
Résultats essentiels :
Sur 15 322 patients dans la cohorte de dérivation et 28 591 patients dans la cohorte de validation, 60 % étaient des hommes, avec un âge moyen de 63 ans. Les principales différences entre les cohortes étaient un IGS2 plus élevé dans Laus’AKI (43.3 ± 19.4 vs 36.7 ± 14) et une plus forte proportion de patients obèses dans MIMIC-IV (34.6 % vs 16.8 %).
Un poids préadmission (ABW) était disponible pour 79 % des patients, tandis que le premier quartile de poids et le poids arbitraire ont été utilisés pour respectivement 4 % et 16 %.
Les modèles utilisant la taille et l’IBWd étaient les mieux corrélés à l’oligurie. En raison de son usage courant en réanimation et de sa relation linéaire avec la diurèse, l’IBWd a été retenu comme best UO predictor (AIC = 127 273, R² = 0.9).
L’incidence de l’oligurie était plus élevée avec l’ABW qu’avec l’IBWd (71.7 % vs 66.3 %), avec une augmentation quasi-linéaire de cette incidence avec l’augmentation du poids préadmission, aboutissant à une probabilité proche de 100 % d’être oligurique pour un poids > 120 kg avec le modèle ABW alors que l’incidence restait stable dans toutes les catégories de poids avec l’IBWd.
L’association entre l’IBWd et les critères cliniques était plus forte qu’avec l’ABW (pseudo-R² de 4.4 vs 2.1 pour la mortalité à J90 et 2.5 vs 1.7 pour la maladie rénale aiguë).
La proportion de patients développant ces critères était plus élevée avec l’IBWd (48.3 % vs 37.7 % pour la mortalité à J90 et 47 % vs 37.8 % pour la maladie rénale aiguë). Cette différence était particulièrement marquée pour les patients > 95 kg.
L’analyse de sensibilité en excluant les patients sans sonde urinaire et ceux sous diurétiques confirmait ces résultats.
L’agrément entre le diagnostic d’IRA par la créatinine et par l’oligurie était médiocre quel que soit le modèle, mais légèrement meilleur avec l’IBWd.
Commentaires :
Cette étude montre que les modèles basés sur la taille, en particulier le poids idéal selon Devine (IBWd), sont des prédicteurs plus fiables de l’oligurie que ceux utilisant le poids préadmission, et sont mieux corrélés aux critères cliniques. L’utilisation du poids idéal pour exprimer la diurèse en mL/kg/h pourrait donc améliorer la spécificité du diagnostic d’oligurie et réduire les faux positifs, notamment chez les patients en surpoids, évitant ainsi des examens et traitements inutiles en pratique clinique. De plus, son association avec des critères cliniques robustes renforce l’intérêt de son utilisation dans les études.
Une autre étude publiée récemment et utilisant la base de données MIMIC-IV (1) a montré qu’en utilisant le poids d’admission, un seuil de 0.3mL/kg/h était plus sensible qu’un seuil de 0.5mL/kg/h pour diagnostiquer l’IRA. Cela est en accord avec l’étude de Monard et al, et confirme que le poids d’admission surestime l’oligurie, particulièrement chez les patients en surpoids très représentés dans la cohorte.
L’identification du « bon poids » est une problématique clé en réanimation pour laquelle des réponses sont apportées par la littérature dans certaines situations comme la ventilation mécanique (volume courant de 6 mL/kg de poids idéal) (2) ou l’ajustement des posologies d’antibiotiques (3).
Toutefois, l’incertitude persiste dans d’autres domaines comme pour la prescription de dialyse continue dont les doses recommandées sont de 20-25 mL/kg/h d’effluent sans précision du poids de référence par les recommandations (4), pouvant induire une sous ou sur-dialyse comme le montre une étude s’intéressant aux patients en surpoids qui retrouvait que la dose délivrée était de 27 mL/kg/h de poids d’admission contre 48 mL/kg/h de poids idéal (5).
Points forts :
Les points forts de l’étude sont :
- Utilisation d’une cohorte de dérivation et d’une cohorte de validation incluant près de 45000 patients garantissant la robustesse des résultats
- Comparaison de nombreuses méthodes de standardisation de la diurèse
- Sélection d’une méthode cliniquement pertinente, facilement accessible et déjà utilisée au quotidien en ventilation mécanique
- Méthodologie statistique rigoureuse, avec des résultats stables entre les cohortes et lors de l’analyse de sensibilité
Points faibles :
Les points faibles sont :
- Un poids préadmission disponible uniquement pour 79% des patients et un poids arbitraire attribué à 16%
- Utilisation du critère « maladie rénale aiguë » à la sortie d’hospitalisation pas habituelle et dont l’interprétation peut être biaisée par la perte musculaire
- Etude rétrospective avec le risque de biais et de données manquantes, ne permettant pas d’établir une causalité entre l’oligurie et les critères cliniques
Implications et conclusions :
L’étude démontre que la méthode la plus fiable pour diagnostiquer l’oligurie est l’utilisation d’un seuil de 0.5 mL/kg/h basé sur le poids idéal dérivé de la taille selon Devine. Cette méthode devrait devenir la norme en pratique clinique pour éviter la surestimation du diagnostic d’oligurie et être intégrée aux futures études sur l’IRA afin d’homogénéiser les critères d’inclusion et d’évaluation (6), contribuant ainsi à l’amélioration des soins en réanimation néphrologique.
Références cités dans les commentaires:
- Machado GD, Santos LL, Libório AB. Redefining urine output thresholds for acute kidney injury criteria in critically Ill patients: a derivation and validation study. Critical Care. 12 août 2024;28(1):272.
- Ventilation with Lower Tidal Volumes as Compared with Traditional Tidal Volumes for Acute Lung Injury and the Acute Respiratory Distress Syndrome. New England Journal of Medicine. 4 mai 2000;342(18):1301‑8.
- Castro-Balado A, Varela-Rey I, Mejuto B, Mondelo-García C, Zarra-Ferro I, Rodríguez-Jato T, et al. Updated antimicrobial dosing recommendations for obese patients. Antimicrob Agents Chemother. 68(5):e01719-23.
- Vinsonneau V, Allain-Launay E, Blayau C, Darmon M, Cheyron D du, Gaillot T, et al. Épuration extrarénale en réanimation adulte et pédiatrique. Recommandations formalisées d’experts sous l’égide de la Société de réanimation de langue française (SRLF), avec la participation de la Société française d’anesthésie‑réanimation (Sfar), du Groupe francophone de réanimation et urgences pédiatriques (GFRUP) et de la Société francophone de dialyse (SFD). Médecine Intensive Réanimation. 1 nov 2014;23(6):714‑37.
- Peters BJ, Barreto EF, Mara KC, Kashani KB. Continuous Renal Replacement Therapy and Mortality in Critically Ill Obese Adults. Critical Care Explorations. nov 2023;5(11):e0998.
- Zarbock A, Forni LG, Koyner JL, Bell S, Reis T, Meersch M, et al. Recommendations for clinical trial design in acute kidney injury from the 31st acute disease quality initiative consensus conference. A consensus statement. Intensive Care Med. 1 sept 2024;50(9):1426‑37.
CONFLIT D'INTÉRÊTS
Article Commenté par Romain Arrestier, Médecine Intensive et Réanimation, CHU Henri Mondor – APHP, Créteil, France
Le contenu des fiches REACTU traduit la position de leurs auteurs, mais n’engage ni la CERC ni la SRLF.
romain.arrestier@aphp.fr ou à la CERC.
CERC
G. LABRO (Secrétaire)
S. BOURCIER
A. BRUYNEEL
A.CAILLET
C. DUPUIS
N. FAGE
JP. FRAT
G. FOSSAT
A. GAILLET
S. GENDREAU
S. GOURSAUD
N. HIMER
O. LESIEUR
A. ROUZÉ
M. THY